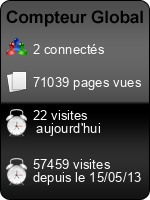Hommage à Jean Rollin, par Raymond Audemard.
Avant que je ne fasse sa rencontre, Jean Rollin était pour moi un réalisateur de films un peu fou – dans le bon sens du terme -, un homme possédé par une passion de filmer, contre vents et marées, une sorte de Mocky du fantastique, dédiant sa vie à un cinéma de genre si méprisé en France, alors que les auteurs italiens ou américains étaient déjà admis dans la « cour des grands », même si c’était du bout des lèvres…
Pour certains amateurs (on dirait maintenant des geeks) il était le Ed Wood français, ce qui n’était pas forcément une comparaison flatteuse, Ed Wood étant resté dans les mémoires (de ceux qui le connaissaient) comme le réalisateur de quelques films calamiteux dont Plan nine from outer space, film de science fiction totalement fauché et monté de bric et de broc. Ed Wood était pratiquement tombé dans l’oubli avant que Tim Burton ne lui consacre un film.
Mais si Jean Rollin campait à la périphérie de mon univers fantastique et science fictif, tout a changé lorsque les circonstances de la vie et d’une « carrière » un peu erratique m’ont permis de le rencontrer, non seulement comme cinéaste, mais aussi comme écrivain et directeur de collection.
Chroniqueur littéraire de SF au sein d’une radio associative et généraliste (TSF, devenue TSF Jazz), j’étais entré dans le domaine éditorial par la petite porte (ghost writer au sein de l’équipe d’auteurs d’une série publiée par les Presses de la cité et Gérard de Villiers – Blade) avant d’y diriger une collection. Et là, dans les bureaux des éditions Fleuve noir (UGE Poche – Presses de la cité), je fis la connaissance d’un homme d’une grande gentillesse, élégant, d’une éducation parfaite et d’un solide sens de l’humour : Jean Rollin !
Il dirigeait une collection de romans fantastiques de poche (Frayeurs) où se retrouvèrent de nombreux jeunes auteurs, certains venant tout droit des milieux du cinéma qu’il connaissait bien, d’autres faisant, sous sa houlette, leurs premiers pas dans l’écriture. Je compris très vite, au-delà de nos différences de culture, j’appartenais plus au monde de la SF et du polar qu’à celui du fantastique, que Jean était un « pur », un homme véritablement amoureux d’un de ces genres que les cuistres incluent dans la « paralittérature ».
Attachant, plein de malice et doté d’une volonté de fer, il continuait à tourner, tout en écrivant et en amenant au livre des inconnus qui n’avaient jamais eu la chance de disposer d’une collection véritablement ouverte aux jeunes auteurs.
Malgré la maladie qui l’épuisait (de douloureuses et fréquentes séances de dialyse en attente d’une greffe rénale qui n’interviendra que beaucoup plus tard) il était sur tous les fronts, avec toujours le même calme et la même forme d’humour taquin qui avait élevé certains de ses tournages au niveau d’anthologie du cocasse pour quelques uns de ses acteurs – n’est-ce pas Véronique …
Erudit véritable dans le domaine de la littérature populaire, grand lecteur, curieux et amateur de longue date de ces auteurs oubliés ou méprisés (même si les surréalistes réhabilitèrent ce domaine en leur temps – merci à eux !), il était accessible et jamais pontifiant.
Son appartement du 20ème arrondissement de Paris était une manière de musée personnel où livres, cassettes vidéo, objets et souvenirs de tournage composaient une sorte de portrait de l’homme qui y habitait et de ses passions. Mes yeux erraient j’étais fasciné par cette authentique grotte au trésor !
Nos rencontres place d’Italie, au siège des Presses de la cité, étaient un plaisir et m’ont permis de découvrir un personnage doté d’une volonté farouche, sans pour autant se départir d’une exquise urbanité, sans concessions par rapport à ses goûts et ses objectifs et prêt à y consacrer toute son énergie.
J’ai eu le plaisir de participer pour une (trop) courte journée au tournage de son film Les Deux orphelines vampires, dans une épicerie située à proximité du Musé du Vin à Paris 1995. C’était ma première (et dernière) expérience d’un plateau de cinéma, et même si les moyens n’avaient rien d’Hollywoodien, le sérieux et le professionnalisme étaient de mise. Jean était fatigué, mais repoussait les limites de ses forces pour donner naissance à son nouveau film. Acteurs comme techniciens faisaient pour beaucoup partie de la « tribu » de Jean, fidèles au poste, prêts à s’investir financièrement et personnellement pour contribuer à l’éclosion d’un rêve. Mais d’un rêve bien réel, avec ses contraintes, ses finances limitées, ses cadences de tournage rapides, ses difficultés techniques ou la paresse intellectuelle des distributeurs et des diffuseurs. Jean était fatigué, très fatigué, assis sur une chaise pliante, le visage amaigri, les yeux enfoncés dans les orbites.
A cette époque, seuls quelques amateurs de « cinéma bis » connaissaient Jean Rollin, le grand public n’avait que rarement eu l’occasion de voir ses films. Cette période marqua pourtant une amorce de reconnaissance publique, avec une page entière en dos de Libération et des interviews télévisées (dont une, restée dans ma mémoire, tournée au Musée de l’Erotisme, dans le 18ème arrondissement). J’eus, à plusieurs reprises, la joie de recevoir Jean dans l’émission que j’animais chaque semaine, Un cadavre dans la soucoupe, accompagné de quelques uns de ses auteurs, parmi lesquels Gudule [Anne Duguël], auteure de nombreux livres pour la jeunesse, amateur de fantastique (et qui interprétait une savoureuse bonne soeur dans Les deux orphelines vampires).
Aujourd’hui, sur la câble ou le satellite on peut voir fréquemment ses films, mais il n’en était rien alors.
Au fil du temps, plus familier de ses films, je découvrais l’unité de son œuvre, des caractéristiques souvent présentes, des décors reconnus : le cimetière du Père-Lachaise, une plage de Normandie, les restes d’une jetée de bois disloquée par le jeu du temps et de l’onde, une rose de fer…Des thèmes récurrents : double et gémellité, vampirisme et morts vivants, un saphisme à peine esquissé, des décors de ruines et de cimetière, une imperceptible fascination amusée pour les bonnes sœurs, et une tension érotique qui ne dérapait jamais.
Bien sûr, je préfère certains films à d’autres, mais Jean est au cœur de chacun d’entre eux. Du Viol du vampire – un premier film en forme de manifeste, quasiment expérimental, tourné en noir et blanc, entre théâtralité assumée et audace esthétique – à La nuit des horloges, en passant, entre autres, par Les raisins de la mort, Fascination, La fiancée de Dracula, La nuit des traquées ou La rose de fer (sans doute mon préféré, angoissant et minimaliste jusqu’à n’être plus que l’épure d’un film « de genre ») tout un itinéraire parsemé d’acteurs, et surtout d’actrices (car Jean Rollin aimait à l’évidence filmer les femmes), de rencontres, de galères et de fidélité. Fidélité à lui-même et aux autres, fidélité au fantastique, fidélité à une écriture et un ton qui lui étaient propres.
Paradoxalement, Jean Rollin était bien plus connu à l’étranger qu’en France, invité d’honneur de festivals internationaux, ses films étaient traduits dans plusieurs langues, ses B.O publiées en CD. Nul n’est prophète en son pays, dit l’adage, mais il est dommage qu’il n’ait pas eu les moyens de donner forme à tous ses projets, de communiquer plus et mieux son amour du fantastique et du cinéma.
Le hasard (il est vraiment partout !) a voulu qu’après les Presses de la Cité nous nous retrouvions, dans le même rôle, aux éditions Florent Massot. Erreur de casting pour Jean comme pour moi, la littérature populaire n’était pas au centre des préoccupations d’un éditeur sans doute trop jeune et trop décalé. Sans se décourager, Jean a continué aux Belles lettres, tandis que j’obliquais vers le polar de gare et l’audiovisuel. Nos routes se sont séparées sans que je ne le veuille, ni le souhaite.
La dernière fois que je vis Jean ce fut le jour de mon mariage où je l’avais convié, comme on convie un ami. Ce n’était pas une bonne idée, pas l’invitation, surtout pas, mais le mariage !
Lorsque Véronique D.Travers, fidèle entre les fidèles, photographe de plateau, actrice à l’occasion, administratrice de sa maison de production et surtout amie sincère, m’apprit la mort de Jean en 2010, je compris tout ce que j’avais raté, toutes les conversations que je n’aurais jamais, les anecdotes qu’il ne me raconterait pas. J’avais songé à écrire sur lui, ce personnage rieur et sérieux, toujours entre plume et caméra, habité par des images qui le suivaient dans toutes ses facettes. Je n’en ai pas eu l’occasion, Pascal Françaix a pu le faire, je l’envie et je lui suis reconnaissant d’avoir donné la parole à un Grand Monsieur.
La maladie l’avait terrassé, la Camarde avait fini par rattraper celui qui l’avait si souvent côtoyée et apprivoisée en la mettant en mots et en images.
Et ce jour là, j’ai pensé à cette phrase finale d’une des plus belles chansons de Brel :
Et maintenant, je vais pleurer.
Raymond Audemard
janvier 2013.
Hommage J.R. by Raymond Audemard
G-E6NH8JM7S2

sur le site officiel français dédié à
Jean Rollin, cinéaste-écrivain
03 novembre 1938 - 15 décembre 2010