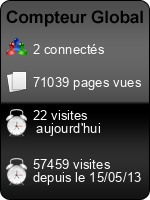La rose de fer s’élève comme un bloc, une œuvre libre. Ce qui en fait aussi le film le plus mésestimé de l’inimitable Jean Rollin.
PAR JEREMIE MARCHETTI
Pendant bien trop longtemps, Jean Rollin, l’homme, le mot lui même, était devenu presque une insulte. En particulier lorsque le cinéma de genre français commença sérieusement à se remuer dans les années 2000 et qu’il fallait trouver un coupable. Une cible aisée, car le bonhomme fut le seul à maintenir un rythme constant dans son amour du fantastique, avant de perdre petit à petit la main à la fin des années 80. Un cinéma du terroir naïf, maladroit, usé par les mêmes obsessions: voilà ce qu’était le petit Jean pour beaucoup de monde. Ailleurs, le bonhomme est culte comme Fulci ou Franco chez nous: le label Redemption a par exemple édité tous ses films, et n’a jamais lâché l’affaire. Et il a bien raison.
Rollin, c’était peut-être des approximations (comme si les italiens étaient mieux lotis…), mais c’était une âme, une patte, un esprit. Qui peut se targuer en France d’avoir aussi bien utilisé les paysages de nos régions à des fins gothiques ou fantasmagoriques? Pas grand monde justement. Si on l’a vite catalogué, pas forcément à tort, comme un grand obsédé des femmes vampires, il faut revoir son film le plus fragile, le plus beau et le plus morbide. Paradoxalement, c’est aussi le plus dépouillé, le plus abstrait, le plus épuré. Pas de crocs, pas zombies, pas de gore. Pas de surnaturel même.
Lui, elle. Ils se rencontrent à un mariage. Lui, grand dadais de velours qui crâne en récitant des poèmes. Elle, poupée sucrée qui regarde les choses d’un œil distrait. Ils se retrouvent dans une gare abandonnée, s’amusent. Sur le chemin, il décide de l’emmener au cimetière. Elle ne veut pas. Il insiste. Et les voilà plongés dans le cimetière d’Amiens, jungle de pierre et de feuilles, traversée par des silhouettes sinistres (un clown, une vieille dame, un vampire et Rollin lui-même). Ils font l’amour dans un caveau. Quand ils sortent, la nuit est tombée. On a fermé les grilles. Ils ne retrouvent plus leur chemin, et commencent alors à perdre la raison…
Un somptueux travelling arrière suffit à désorienter personnages et spectateurs, à transformer un simple cimetière en royaume impénétrable. Les voix des morts s’élèvent. Tout bascule. Folie que de tourner avec deux acteurs seulement, sur une trame maigrichonne, en pleine nuit dans un décor sans éclairage. Mais la candeur de Françoise Pascal et le charisme de Hughes Quester soutiennent follement cette ballade entre les tombes. Une déclaration d’amour faites aux cimetières, ville des morts coupée du monde, offrant un champ lexical sans limites de dalles fêlées, d’anges de pierre, de cryptes ouvertes. Un chant nécrophile dont il vaut mieux accepter la lenteur funèbre, qui conduit petit à petit le spectateur à son tour sur les chemins de la déraison. Qu’importe le sens de tout ça (les retours sur la plage fétiche de Rollin et la fameuse «rose de fer»), qu’importe les monologues énigmatiques de Françoise Pascal («ils ont refermé les portes du château de cristal…») : il faut s’arrêter pour y sentir les parfums qui s’y exhalent, jouir de l’incroyable sens de l’atmosphère de Rollin (les cloches sonnant dans le lointain, le bruit des os tintant à côté des amants faisant l’amour, les cadrages minutieux et labyrinthiques), entendre la musique terrifiante de Pierre Raph qui semble composée par les morts eux-mêmes. Et puis goûter à cet épilogue perturbant et baudelairien, qui se referme sur nous comme la dalle d’un tombeau.





























Françoise Pascal dans le film
La rose de fer ~ The lady of the manor
©Photo : Droits réservés®




























































La Rose de Fer (1973) - Opening Sequence - source Youtube
Source YouTube - DavidFromLille
Posté par BBJane Hudson
https://www.youtube.com/watch?v=0iJcxV0_Ht0
Petit montage vidéo posté par David From Lille
©Photo M.Maiofis droits réservés®
©Photo M.Maiofis droits réservés®
©Photo M.Maiofis droits réservés®
©Photo M.Maiofis droits réservés®
©Photo M.Maiofis droits réservés®















G-E6NH8JM7S2



sur le site officiel français dédié à
Jean Rollin, cinéaste-écrivain
03 novembre 1938 - 15 décembre 2010