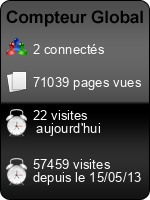Texte paru dans le n° 3 de Cut
septembre 2013
Nous allons conclure notre entretien sur votre participation à divers bonus DVD…
Ah ça, c’est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le premier que j’ai fait, c’est Le Dernier Face à Face.. Thierry Lopez d’Artus film a vu ma prestation et m’a contacté pour La Sorcière Sanglante puis Les gardiennes du Penitencier, une bouse Eurociné construite à partir de stock- shots extraits d’un film de prison de femmes réalisé par Jess franco. Je me suis éclaté à dire la vérité, rien que la vérité. Mais le travail dont je suis le plus fier, c’est mon intervention sur le coffret Winnetou qui est sorti voici quelques mois chez M6 SNC vidéo. Là, j’ai mouillé la chemise gravement ! ….

Le bilan de cette aventure est plutôt positif puisqu’il a permis de révéler Mario Bava et avec Quartiers Interdits vous avez diffusé pour la première fois la version intégrale de L’Enfer des Zombies de Fulci. Il y a quand même une certaine vision du cinéma qui a touché toute une génération de téléspectateurs…
Il faut dire que Mario Bava, c’est une volonté profonde de Jean Pierre Dionnet. Moi, j’avais rien contre, bien au contraire. Quartier Interdit, c’est un enfant que j’aime bien. Au Cinéma de Quartier, on n’avait pas le droit de diffuser des films interdits au moins de 12 ans et plein de films de la Hammer étaient encore frappés par cette interdiction. Faut dire que les Majors, rien ne les fait plus chier que de re-soumettre un de leurs films à la censure alors qu’ils seraient tous devenus « tout public ». Un jour, j’en ai parlé à Jean-Pierre. Pourquoi ne pas faire un Cinéma de Quartier pour adultes avec tous ces films impassables le mercredi matin. Le projet a dû lui plaire , il en a parlé à la direction de Canal. Il est revenu un jour avec cette idée de Quartier Interdit, mais sous une forme beaucoup plus axée sur le cinéma contemporain. parce que Canal + achetait des films d’horreur récents dont ils ne savaient que faire. Je suis très fier d’avoir contribué à la programmation de films comme La Comtesse Noire, Kolobos ou le britannique Moi, un Zombi, qui est un film fabuleux !
Anthropophagus aussi.
Ah oui, là on a eu du mal avec ce film. Il était tombé mystérieusement dans les mains de la MGM qui ne savait pas où était le négatif et la version française. Il a fallu qu’on leur donne tous les renseignements. En regard de L’Enfer des Zombies, il n’y avait pas de VF pour la version intégrale. Donc, il n’y a eu que la version sous-titrée avec une diffusion tardive pour la version intégrale… C’était quand même un peu risqué parce que Canal + qui est une chaîne commerciale comme les autres, était tenu de diffuser les films dans leur version autorisée par la censure. Je crois que l’émission s’est arrêtée pour faute d’audience et aussi parce que des collaborateurs de Canal jugeait cette programmation trop « limite », voire indécente et s’en était plaint ouvertement auprès de la nouvelle direction… Grâce au dictat des quotas français, on a même pu programmer du Jean Rollin ! Jean pensait être sur une liste noire. Mais en fait, pas du tout. Après que ses films soient passés sur Canal, toutes les chaînes du câble ont suivi dans la mouvance. Mais l’émission étant hélas défunte et puisqu’il faut bien parler de bilan, je dois dire que Cinéma de Quartier a permis de sortir du placard des dizaines de films qui n’intéressaient plus personne et qui ont, du coup, connu une seconde vie. Si on ne s’occupe pas des films, ils meurent… Trop souvent, on se heurte à des problèmes strictement matériaux, notamment pour retrouver la VF. En fait, Cinéma de Quartier, n’a peut -être existé si longtemps qu’en raison des besoin de la chaîne en matière de films français. Pour une coproduction franco-italienne ou franco-allemande des années 60s programmée à CDQ, Canal diffusait un blockbuster américain des années 90s..
Qu’auriez-vous aimé faire et qui ne s’est jamais fait ?
C’est vrai que dans les années soixante-dix, j’aurais vraiment aimé devenir scénariste. A ce propos, j’ai eu un autre projet avec Jean Rollin. On devait faire un film à quatre, un film où chacun aurait réalisé 20 minutes. Pas un film à sketches mais une seule histoire avec 4 réalisateurs (Jean Pierre Bouyxou, Pierre Pattin, Jean Rollin et votre serviteur) qui se seraient passé le relais pendant 20 minutes consécutives. C’était un défi intéressant et une expérience sans réel précédent, je crois. Au début, ça devait s’appeler French Gore… On s’était inspiré du Masque du Démon avec une histoire de résurrection de sorcière. Howard Vernon, Pierre Clementi, Brigitte Lahaie et Serge Marquand étaient d’accord. La genèse du scénario a été difficile pour des tas de raisons et quand on a montré notre premier jet à Jean Rollin, il nous a dit : « les p’tits gars,vous allez trop loin ! » On a dû tailler vilain dans le Gore. Puis, on a changé de titre et c’est devenu Catacombes. Au final, il nous a manqué 50 000 francs pour boucler le budget. Une misère, mais le projet est tombé à l’eau! On avait même fait des photos de pré- production avec certains des comédien, l’une d’elle a même été publiée dans un Starfix de l’époque. J’ai précieusement préservé une copie de ce script car je garde un souvenir ému de quelques après- midi studieux autant que délirantes avec mon poteau Jean Pierre Bouyxou. Travailler avec lui, ce fut un vrai bonheur.
Avant de conclure sur votre actualité, nous aimerions savoir si vous aviez des coups de cœur actuellement.
Je me tiens au courant des sorties mais j’éprouve moins d’urgence à voir les films parce qu’il y a les sorties DVD certaines dans les mois qui suivent. Pour tout dire, je me sens un peu moins concerné par l’actualité, Voilà. J’ai l’impression d’être un conservateur de musée ! Mais j’ai encore des coups de cœur. Je trouve juste dommage que les bons réalisateurs Français doivent aller aux Etats-Unis pour faire leur films. Il y a heureusement des exceptions, des films comme Saint Ange, Sheitan ou encore Frontière(s) qui sont vraiment épatants.
Et les cinéastes des années 70/80 qui tournent encore, vous en pensez quoi ?
Des noms, des noms...
Tobe Hooper ?
Un génie total !. Mortuary est fabuleusement jouissif ! Tout ce que j’aime est dedans, c’est excessif, dingue, inventif. Et puis Funhouse, c’est un de mes films préférés !
Dario Argento ?
… Ah… J’ai longtemps défendu Argento. Quand, à partir de Phenomena, il s’est fait démolir, je l’ai défendu. Mais, son Fantôme de l’Opéra avec Julian Sands… et puis la Troisième Mère, c’est pas possible. Non, vraiment. J’ai pas tenu jusqu’au bout tellement j’ai trouvé ça pathétique. Ça aurait dû rester une trilogie inachevée…
John Carpenter ?
Il est bien ce p’tit gars-là. C’est un rebelle à Hollywood, un mec intègre. Et avec son The Thing, c’était la première fois que je voyais un remake aussi bien que l’original !
Wes Craven ?
C’est un type très rusé, Craven, très malin, mais pas un grand cinéaste. Un artisan…
Michele Soavi ?
Alors là, il n’y a rien à jeter. Je suis même tombé sur un de ses téléfilms (Aller Simple pour l’Enfer) qui est excellent. Il faut qu’il continue à travailler, ce bonhomme. Il devient même meilleur qu’Argento !

Savez vous qu’un des gros plans de la scène ou je me fait découper à la tronçonneuse en forêt a été tourné dans l’appartement parisien que j’occupais alors ? Incroyable, non ? et personne n’a jamais rien remarqué !
Vous évoquez la fine fleur du fanzinat français et on a l’impression que les années 70 en sont un peu l’âge d’or avec Cine Zine Zone de Pierre Charles… Ah, Cine Zine Zone, ça, c’était bien. Zombi Zine aussi de votre ami feu Pierre Pattin…
Oui, il y a eu beaucoup de fanzines à cette époque! Mais la plupart se contentaient de faire chaque année un compte rendu du festival du Rex. Les mecs ne cherchaient pas à savoir quelle était la carrière de tel ou tel acteur… Il n’y avait aucune recherche. Mais heureusement, de cette multitude ont émergé des choses intéressantes. Pierre Charles a le record de longévité avec plus de cent numéros quand même. Et tous intéressants ! Pierre Pattin, lui, avait inventé une nouvelle forme de fanzine. C’était le foutoir absolu et il s’exprimait avec une grossièreté à toute épreuve. C’était un fanzine vraiment anarchique. Il n’y avait aucune cohésion. Moi, j’ai écrit deux ou trois papiers dans son truc, mais c’était n’importe quoi ! Il publiait des pavés presse au milieu de la page, etc… Mais aujourd’hui, c’est culte. Et c’est bien parce que Pierre, c’était quelqu’un d’intéressant…
Il a été un des premiers à défendre Fulci… Ah oui, il était parfaitement délirant vis-à-vis de Fulci. J’ai beaucoup de souvenirs de Pierre…
Christophe Lemaire se réclame beaucoup de la liberté de ton de Pattin.
S’il le dit, c’est sans doute vrai parce qu’ils étaient très, très potes. Il faudrait presque écrire un livre sur Pierre ! Mais il faudrait s’y mettre à plusieurs parce que c’était quelqu’un qui avait plein de facettes. C’était surtout quelqu’un qui était foncièrement malheureux. Je pense qu’il avait du talent mais il était prisonnier de son anarchisme forcené, en fait. Il se voulait anarchiste alors qu’il était issu d’une famille bourgeoise et il ne pouvait rien faire pour effacer ça. Alors il se noyait dans l’alcool…Dommage car, il avait un vrai talent de cinéaste . Il l’a prouvé à 3 reprises avec ses courts métrages.
Vous avez aussi collaboré à Mad Movies. Quel rapport affectif avez-vous avec cette revue ?
J’ai suivi l’affaire très tôt parce que j’étais à la librairie de La Dame Blanche (un haut lieu du fantastique parisien, en ce début des seventies) le jour où Jean-Pierre Putters est venu déposer son numéro 1. Lui-même le dira, les deux premiers numéros étaient nases. Puis l’intérêt est allé croissant à partir du N°3. Je pense qu’il a atteint sa majorité avec le numéro dix-sept ou dix-huit. Il est passé d’une écriture « fanzinesque » à une écriture plus mature d’un seul coup. A partir du numéro 3, il n’était plus tout seul. Avec quelques autres, je collaborais de temps à autre, il avait donc des collaborateurs intéressants (rires) ! Quoique moi, je n’ai collaboré que très épisodiquement.
Mais comment êtes-vous devenu un régulier avec notamment la rubrique vidéo ?
Vraiment, vous savez tout ! Je le suis devenu un peu par la force des choses car j’avais des contacts amicaux réguliers avec Jean Pierre et tenir la rubrique Vidéo, ça m’a intéressé un temps à cause des services de presse . C’est à cette époque que j’ai pris la gérance de Movies 2000. J’ai été professionnellement heureux pendant ces deux années-là avec beaucoup de rencontres intéressantes comme Stéphane Derderian et quelques autres, mais financièrement, c’était pas ça. Puis j’ai changé, j’ai pris un local où je ne vendais plus que des photos en gros. J’étais devenu laborantin dans la photo industrielle. A Paris, on commençait à ne plus se sentir très bien et on s’est dit que quitte à prendre la voiture pour aller vendre nos produits aux quatre coins de l’hexagone, pourquoi ne pas le faire avec pour point de départ un endroit où la vie est plus douce. Donc, direction : le Sud. Mais le boulot est devenu de plus en plus pénible, Avec l’émergence de la Vidéo, les gens se sont progressivement éloignés du fétichisme la photo. Ça a été un long naufrage... Et c’est là qu’est intervenu mon ami Carlos Sylva qui a parlé pour moi en regard d’une collaboration au Cinéma de Quartier car Jean Pierre Dionnet avait besoin d’un assistant pour son émission.
C’est donc en 1992 que Dionnet vous embauche pour Cinéma de Quartier sur Canal + en tant que « nègre » ?
Officiellement, j’ai été engagé en tant que « conseiller cinématographique ». C’est ce qui était inscrit sur mes bulletins de salaire. Au départ, on m’envoyait des cassettes à visionner et je devais faire un rapport pour dire ce que j’en pensais. J’étais payé au film. Après les choses ont évolué. Petit à petit, on m’en envoyait de plus en plus. A l’époque, JPD, faisait une multitude de choses sur plusieurs chaînes du câble et même en étant très actif, il y a des cas d’espèce où l’aide d’un « nègre » est la bienvenue. J’ai commencé à rédiger le premier jet des textes de présentation des films, par la suite on m’a demandé de réfléchir aux programmes à venir, d’explorer les catalogues des vendeurs français et étranger pour y trouver les perles rares programmables dans le cadre du Cinéma de Quartier. Progressivement, je suis réellement devenu conseiller cinématographique de l’émission .
Et au fil du temps, vous avez dû vous investir encore plus dans le Cinéma de Quartier…
(…) C’est quelque chose qui m’a été demandé… De surcroît, Jean-Pierre a été souffrant pendant une très longue période et du coup, il n’était plus aussi présent. J’ai donc très occasionnellement été amené à prendre des décisions à sa place, mais toujours dans l’urgence et toujours dans l’intérêt de l’émission . Il faut dire que Jean Pierre est, quoi qu’il soit advenu, resté seul maître à bord, que toutes les décisions ayant rapport à la programmation passaient par son veto. Il nous arrivait d’être en désaccord sur certains titres mais les impératifs de l’émission (et notamment le pesant dictat des quotas français) nous ont toujours amené à une concorde finale. Je n’ai jamais cherché à être calife à la place du calife. Je pense avoir été de bon conseil, sinon, je n’aurais pas travaillé aussi longtemps pour CDQ. 9 ans, ce n’est pas rien ! Il faut dire aussi que nous étions secondé par Anne Vincendeau, une secrétaire formidable, une perle comme on n’en fait plus, qui s’investissait à mort dans son travail.
Orgoff de Norbert Moutier

C’était par amitié ou pour votre talent d’acteur ? (rires)
Par amitié et aussi par économie je pense ! (rires) Le premier (De Sade’s Juliette), c’était un film qu’il produisait lui-même et qui a été racheté « clés en main » par un producteur italien. Il tournait souvent deux films à la fois et parvenait parfois à en commencer un pour lui. Jess est sans doute beaucoup de choses, mais ce n’est pas un escroc ! Il a toujours honoré ses contrats et les producteurs pour lesquels il a œuvré n’ont jamais eu à se plaindre de ses services C’est avant tout un toxico de la caméra. Il n’est jamais plus heureux que lorsque son œil se colle à l’œilleton de la caméra et qu’il dit « moteur ! ».
Il y a un autre cinéaste très décrié que vous semblez apprécier, c’est Jean Rollin. On a envie de vous posez la même question : qu’est-ce que vous aimez dans son cinéma que les autres ne voient pas ?
(rires)… Ben, Jean Rollin, au départ, c’est un cinéaste dont je n’appréciais pas beaucoup les films. C’est tout le contraire de Jess Franco, en fait. Et puis je l’ai rencontré à l’occasion d’un festival de Cinéma Fantastique de Paris. Alain Schlockoff voulait visionner La Rose de Fer qui n’est pas le Rollin le plus accessible, en plus, pour savoir si on pouvait le programmer ou pas . Lors de la projection test,les gens présent ont estimé que oui. On a donc passé le film et ça a été une catastrophe… En fait, Jean avait rendu service à deux de ses actrices qui avaient travaillé pour un escroc. Il avait fait un acte de chevalerie que l’autre n’a pas du tout apprécié. Donc, le soir de la projection, une dizaine de perturbateurs à la solde de l’escroc est entrée dans la salle… Et ça, c’est quelque chose d’imparable. Il n’y a rien de plus facile à faire que d’assassiner une projection. Et le public, qui est con par excellence, a suivi, comme des moutons de Panurge. Ce soir là, la réputation de Jean Rollin en a pris un sacré coup et il est quasiment devenu impossible de passer un de ses films dans un festival français pendant très longtemps. Personnellement, j’avais pas du tout aimé Le Viol du Vampire. Du coup, je n’étais pas allé voir le deuxième, mais le troisième était pas mal. J’ai vraiment commencé à aimer l’œuvre de Rollin avec Lèvres de Sang. Puis nous avons eu des projets communs, même s’ils n’ont pas abouti, ça créé des liens affectifs. Il y a des films de Jean Rollin que je ne supporte pas et puis d’autres que j’aime beaucoup. Fascination est un film que j’apprécie beaucoup. Avec le temps, j’en suis même venu à aimer Le Viol du Vampire. Ce sont des films qui ont une identité propre, aux antipodes des films d’horreurs anglo-saxons que l’on pouvait voir à l’époque et qui finalement polluaient quelque peu notre sens critique. Les films de Rollin n’étaient pas « coulés dans le moule » de la tendance contemporaine, de l’esthétisme gothique dans l’air du temps. Et c’est sans doute tant mieux car c’est ce qui fait aujourd’hui qu’il est si important en regard de l’histoire du cinéma fantastique. Je lui ai dit une fois, et ça l’a fait marrer, qu’il était à la fois le meilleur et le pire réalisateur de films fantastiques français. A l’époque, en effet, il était le seul ! Mais, pour être franc, en tant que cinéaste, Rollin m’emballe moins que Franco.
Et vous avez joué dans Ogroff de Norbert Moutier aussi !
Oh là là ! ça au départ, c’était pas un film professionnel ! Il y avait la fine fleure du fanzinat français. Tout le monde était là ! Pierre Pattin, Jean-Pierre Putters, etc… Chaque zombie, c’est quelqu’un de connu dans le fanzinat. Norbert, il n’avait pas les pieds sur terre. Il avait les exigences d’un vrai metteur en scène mais il n’avait pas les moyens. Il voulait, par exemple tourner un plan où le tueur attérit au sol, face à ses futures victimes. Bon, c’est un très beau plan, ça, mais il n’avait que deux espèces d’échelles métalliques et une planche qui reposait sur les barreaux pour sauter au sol de la hauteur de la planche. Il me demande à moi et à une autre personne de tenir chacun une échelle pendant qu’il monte sur la planche ! Je lui ai dit : « Pas question! Si un des deux lâche prise, l’autre se retrouve écrasé comme une merde de l’autre côté ! » Quelqu’un d’autre a bien voulu le faire et vous savez quoi ? ça a marché … Ensuite, il voulait que je me colle au bout des poignets des morceaux de barbaque qui étaient restés au soleil depuis le matin. Ça sentait le cadavre grave ! On l’a fait avec du coton et de la peinture rouge et ça allait tout aussi bien.

Avez-vous écrit d’autres scénarios ?
Pour Jess, j’ai écrit les dialogues et l’adaptation de Plaisir à Trois, Les Chatouilleuses et Le jouisseur, mais presque toujours dans des conditions catastrophiques. Il m’est arrivé aussi de faire bénévolement pour lui de petits travaux. Je lui faisais, par exemple, des résumés de films qu’il voulait tourner. Un jour, il me dit qu’il va tenter de décrocher un contrat de neuf films et il me les raconte tous du début à la fin ! C’était incroyable. C’est du génie à l’état brut. C’est aussi à cette période qu’il m’a demandé de tenir des petits rôles dans ses films. Pour Jean Rollin j’ai travaillé sur deux projets qui n’ont pas vu le jour. J’ai assuré seul la rédaction de An American Vampire in Paris, écrit sur mesure pour le couple Joe Spinell- Brigitte Lahaie. Spinell est mort avant que le film ne se monte. C’est bien dommage car j’aimais beaucoup cette histoire et Joe Spinell était très excité par le final qui se déroulait sur les toits de Beaubourg. Le reste de ce que j’ai pu écrire repose au fond d’un tiroir, comme ce Clown de Minuit, écrit dans les années 70s avec mon vieux pote Alain Venisse , longtemps avant le Ca de Stephen King. Alain en a d’ailleurs fait un superbe roman publié au Fleuve Noir voici quelques années sous le même titre. C’est réconfortant de penser qu’on n’a pas travaillé pour rien, en l’occurrence.
En tout, vous avez tourné dans trois de ses films, c’est ça ?
Deux sont sortis en salle en France en leur temps…L’autre, plus récent, est sorti en DVD aux USA sous le titre Tender Flesh.
Bref, je montre à ma copine le visage de Franco qui joue dans son film et le lendemain, elle me téléphone pour me dire qu’elle vient de le croiser dans la rue ! J’étais malheureux comme tout… Je lui demande d’appeler la maison de production de Franco qui était sur les Champs Elysées pour essayer d’obtenir un rendez-vous. Elle me rappelle une heure après pour me dire qu’elle a contacté Robert de Nesle et que ce dernier lui a donné le numéro de téléphone de l’hôtel de Jess. Elle l’a appelé et j’ai rendez-vous pour lendemain matin. En fait, il savait qui j’étais parce que je lui avais envoyé mes textes à l’une de ses anciennes adresses et le courrier avait suivi. Notre entretien a duré de dix heures du matin jusqu’à cinq heures de l’après-midi. Je découvre qu’il avait fait une vingtaine de films que je ne connaissais pas du tout. Il tournait à l’époque une moyenne de dix films par an. Je l’accompagne à l’aéroport et dans le taxi, il me dit qu’il a un projet de film pour un producteur français. C’était un film de prison de femmes mais il n’avait pas de scénario. Il m’a demandé de lui écrire un synopsis avec les scènes imparables dans le genre, et pour le reste, j’avais une totale liberté. Jess Franco, c’est quelqu’un dont le simple contact stimule l’imagination. J’ai donc écrit ce scénario et lui ai envoyé très vite. De retour à Paris, il m’appelle pour me dire qu’il le trouve très bon mais que le producteur ne veut plus faire le film !

Mais, à l’époque du Masque de la Méduse, pour retracer sa carrière, j’ai dû faire une véritable enquête de police . Ses films ne sortaient pas en France et il n’y avait ni internet ni imdb à l’époque. Le premier qu’on ait eu au terme d’un délai de plusieurs années de silence, c’est Les Nuits de Dracula en 1970. Ça correspondait au moment où je sortais le numéro 3 du Masque de la Méduse. Je voulais le rencontrer parce que j’avais mille questions à lui poser. En 1973, j’emmène ma compagne voir La Fille de Dracula… c’était peut être pas le meilleur film pour aborder l’univers de Jess Franco, mais, bon, aujourd’hui, il y en a qui trouvent que c’est un film génial. Mais c’est ça qui est bien avec Franco, c’est que même si pour moi, c’est son pire film, il y a un mec à côté qui va trouver que c’est son meilleur !

Mais Django est un film qui a moins bien vieilli que le cinéma de Leone.
Il est certain que ce sont des films tournés dans des conditions difficiles ! Mais justement, à cause de ça, avec de telles conditions, arriver à un film que transcende à ce point là ! On oublie tout ça. Regardez Jess Franco, on lui a reproché de se servir du zoom… Le zoom, c’est le travelling du pauvre. Tout ça, c’est un contexte économique. Mais au niveau du cœur, j’ai toujours gardé une grande tendresse pour Corbucci et quelques autres. Leone, il est plus à découvrir, il est plus à défendre. C’est une institution et on n’y touche pas. Mais moi, j’aime moins, c’est tout.
Quand Django est sorti en 1966, Pour une Poignée de Dollars de Leone est déjà sorti…
Oui mais je parle du plus grand choc, pas du premier. Alors, en effet, le premier choc, c’est Pour une Poignée de Dollars parce que je me souviens que j’avais été dans la boutique de Jean Boulet (qui est la personne qui a écrit les textes sur le fantastique qui m’a le plus emballé dans toute ma vie). Il m’a dit : "Ecoute, j’ai vu un film, là. Ça passe au Rex à Paris, c’est insensé ! Tout le monde croit que c’est un western américain alors que c’est italien. Il faut y aller absolument car c’est génial !" Donc j’y suis allé et, effectivement, je me suis dit que putain, si c’était italien, c’était quand même bien foutu. Puis, il y a eu le deuxième Leone où là, c’était encore mieux parce qu’en plus de Clint Eastwood, il y avait Lee Van Cleef. Ça commençait à être vraiment ce que le western italien allait devenir. Mais le film qui m’a laissé sur le tapis, c’est Django. C’était le western de la démesure. Le mec avec sa mitrailleuse qui descend, je sais pas, peut-être cent-cinquante types. Mais c’est beau, lyrique. J’ai tout de suite eu un faible pour Corbucci. Après, Leone, jusqu’à Il était une fois dans l’Ouest, ça ne me concernait plus. J’ai été le voir à sa sortie et je me suis dit que ce n’était plus le cinéma que j’aimais. C’est un grand film mais pour moi, ce n’était plus du bis. Ce n’était plus du cinéma populaire, c’était du "vrai" cinéma. Le Grand Silence de Corbucci, c’est un film qui me donne envie de pleurer. Colorado de Sergio Sollima me remplit de joie ! Dès que Tomas Milian apparaît à l’écran et qu’il commence à parler mexicain et à se foutre de la gueule de Lee Van Cleef, c’est de la jouissance à l’état brut. Mais Leone avec l’homme à l’harmonica, ça m’emmerde. J’ai l’impression que les types attendent que la musique s’arrête pour tirer ! C’est un film plein de tics…
Et le dernier grand western spaghetti, selon vous, c’est lequel ?
Ouh là là… Déjà, pour moi, le genre est mort avec l’arrivée de Trinita en 1971. Terence Hill est devenu une super star et à partir de là, il a fait On continue à l’appeler Trinita. Les producteurs italiens se sont dit qu’ils avaient une mine d’or. Ça faisait dix ans qu’il ramait et, du jour au lendemain, il est devenu très célèbre et donc très cher. On est passé à un sub-genre qu’est le western parodique. Quant au dernier grand western, je risquerais de faire une injustice…
Keoma ?
Keoma, bien sûr, vous avez raison ! Mais quand ce film arrive, tout est déjà mort. Il n’y a plus de western italien, ça n’existe plus ! Ou alors, ce sont des sous-sous-sous-Trinita, vraiment des merdes innommables. Et Enzo G. Castellari, un des artisans les plus doués du genre, arrive avec Keoma. Castellari qui fut, longtemps avant Trinita, un des promoteurs du western parodique avec son Je vais, je tire et je reviens…
Au détour d’une réponse, vous avez évoqué Jess Franco… Qu’est-ce qui mérite d’être défendu chez ce cinéaste très décrié ? Parce que vous l’aimez à tel point que vous lui avez consacré un fanzine.
C’est un fanbook en fait. Un fanbook en huit volumes, oui. J’ai plus grand-chose à dire parce que j’ai tellement hurlé tout seul que je suis un peu en extinction de voix. J’ai rencontré Jess en 1973 et puis c’est une amitié qui dure… Je sais qu’il m’aime bien… Pour moi, c’est quelqu’un qui a énormément compté dans ma vie, qui m’a aidé à entrevoir que ma vie, ça pouvait être autre chose qu’une vie de bureaucrate. L’actualité répond à la question puisque la Cinémathèque Française lui consacre, en juin et juillet, un cycle. C’est quand même pas rien. 69 films quand même ! Est-ce un accident, ce chiffre ? (rires)
Savez-vous combien il en a réalisé d’ailleurs ? Environs…
Moi, j’en avais recensé entre cent quarante et cent cinquante, à l’époque de mon bouquin… Il a bossé depuis ! Il y a sûrement des choses qui m’ont échappé, mais je dirai, raisonnablement, qu’aujourd’hui, il doit comptabiliser 170 films. Mais il y a quand même un certain nombre d’inachevés, un petit peu comme dans la carrière d’Orson Welles.
Comment avez-vous découvert son cinéma ?
Avec L’Horrible Docteur Orlof, un dimanche après-midi au Midi Minuit. Ce qui m’a motivé, c’était la présence d’Howard Vernon. J’étais fasciné par sa tronche, par sa malédiction à jouer des officiers nazis… Alors quand j’ai vu qu’il sortait un film d’horreur avec Howard Vernon, je me suis dit, putain ! pourvu que ce soit lui l’horrible docteur ! C’était quand même une belle journée parce que je sortais d’un spectacle à l’Olympia avec en tête d’affiche Jerry Lee Lewis ! Et puis une heure après, le film de Franco ! A l’époque, je n’avais pas de notions de ce qu’était la mise en scène et c’est LE film qui m’a fait prendre conscience de ce qu’était la mise en scène. Je suis sorti de la salle subjugué. Puis je suis retourné le voir deux fois, trois fois… Il n’y avait pas la vidéo à l’époque… Par la suite, j’épluchais Pariscope et je suis tombé sur un autre film de Franco qui s’appelait Le Sadique Baron Von Klaus, toujours avec Howard Vernon. Mais Howard n’était pas le méchant de l’histoire et le film souffrait visiblement de coupes de censure. Du coup, il ne se passait pas grand-chose. Ça rappelait les adaptations allemandes des romans d’Edgar Wallace mais dès que ça commençait à devenir intéressant, clac ! ça coupait ! Après, il y a eu Les Maîtresses du Docteur Jekyll tourné dans des conditions difficiles et qui n’a pas été un grand choc. Il a fait deux films co-écrits avec Jean-Claude Carrière qui sont des perles ! Dans les Griffes du Maniaque qui est un de mes préférés de cette période, puis, tout de suite après, il a fait un truc avec Eddie Constantine qui s’appelait Cartes sur Table, une espèce de parodie jouissive du Alphaville de Godard. Puis, on perd sa trace, il quitte l’Espagne, on ne sait pas ce qu’il devient. Il fait en Italie une parodie de films d’espionnage qui s’appelle Lucky l’Intrépide , film devenu culte aujourd’hui. Il se barre ensuite en Allemagne où les gens produisent ses films. Il en fait un qu’il tourne au Portugal, Necronomicon, qui n’a malheureusement aucun rapport avec Lovecraft. Mais c’est un film surréaliste qui a bien vieilli. Aujourd’hui encore, les gens restent sur le carreau quand ils voient ça. Les gens de la Cinémathèque, en premier ! Ensuite, Jess Franco tourne pour un producteur Anglais qui vend les films avant de les avoir tournés. Tous ces films sont à leur manière des films cultes. Et là, il aurait pu se barrer aux Etats-Unis et devenir un grand réalisateur. Mais il veut rester un franc-tireur et au début des années 70s, il tombe dans l’enfer des séries Z érotiques françaises.

Pour beaucoup, vous êtes l’un des premiers à avoir défendu le western spaghetti. Pouvez-vous nous dire qu’elle a été votre premier choc ? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être défendu dans ce genre et quel est, selon vous, le dernier bon western italien ?
Le premier choc, c’est pas difficile. Scotché au mur, la langue pendante, c’est Django de Sergio Corbucci. A force de fréquenter les salles de quartier, dès 1962, j’avais vu les premiers essais de westerns allemands. J’avoue qu’à l’époque, je n’étais pas foufou parce que pour moi, c’était qu’une mauvaise copie du western américain. Et puis, il y avait tout ce côté culture germanique que nous, en France, on ne connaît pas. En plus, c’était des films bien-pensants, très moralisateurs. J’avais vu quelques essais italiens dont Duel à Rio Bravo qui m’avait bien plu. En plus il y avait Guy Madison qui est un acteur américain que j’aime pas mal.
Et vous avez participez à d’autres titres comme Vampirella ou Creepy…
Alors ça, c’est une autre grande aventure. C’est un souvenir vraiment formidable pour moi parce que… En 71, à la première convention fantastique de Nanterre, j’ai rencontré deux types absolument passionnants : Jean-Paul Naï qui collaborait à L’Ecran Fantastique et Jean-Marie Sabatier qui avait des idées très précises sur le cinéma bis. On s’est dit pourquoi ne pas essayer de faire une revue. Au bout de deux ou trois jours, au téléphone avec Jean-Paul, on se dit qu’on a trouvé le titre de la revue : ça va s’appelé Cinéma Bis. On avait eu la même idée ! Puis on a préparé des textes et Jean-Paul, avec son carton à dessin, a fait le tour de tous les éditeurs de Paris pour entendre un non catégorique. Avec nous, il y avait également Alain Venisse qui a eu un rôle important dans ma vie et dans le cinéma bis. Un jour, il nous appelle et nous dit qu’il a peut-être une solution. Il a rencontré Joel Laroche qui édite Vampirella (et Creepy) en France. Il a un vrai problème, c’est que la moitié de la revue soit du texte. Il nous propose donc une moitié de revue. On balance donc Cinéma Bis à partir du numéro neuf de Vampirella. Et la partie actualité de notre revue avortée sera dans Creepy. Il faut admettre que le numéro neuf de Vampirella était très beau. On a tenu, je crois, du numéro neuf au numéro vingt-trois. Mais c’était de pire en pire parce que l’éditeur, apparemment, ne payait pas l’éditeur américain donc… Mais nous, on était payés. La maquette était faite en dépit du bon sens, le papier était de plus en plus mauvais et l’impression était limite. Nous, nous avons décidé d’arrêter. Mais derrière nous, ce devait être notamment Jean-Pierre Putters qui aurait du reprendre le flambeau.

Dans mon premier numéro du Masque de la Méduse, que j’ai fait vraiment de mes petites mains, l’éditorial, c’était : au secours les gars, je suis vraiment trop seul ! (rires) Puis, je l’ai déposé dans des magasins spécialisés. Bon, l’accueil était sympa et vingt-quatre heures après, j’avais déjà les bases de mon équipe rédactionnelle. Puis chacun des rédacteurs a fondé son propre fanzine auquel je collaborais bien entendu. Skull Island était vraiment très bien malgré une très mauvaise présentation due à une impression à la photocopieuse. Le type, c’était un garçon très gentil qui travaillait dans une banque. Et il tirait son fanzine sur le photocopieur du boulot ! Mais lui, il ne vendait pas son fanzine, il le donnait. J’ai été ravi de tomber en amitié avec lui. C’est quelqu’un que je vois toujours d’ailleurs. L’aventure a duré six mois avec trois numéros. Le numéro trois était un pavé, un double numéro consacré à Jess Franco, déjà… Mais on avait toujours cet éternel problème de la diffusion. J’ai fini par tout vendre. Chez les marchands, il y avait ceux qui étaient enthousiastes et qui avaient surveillé le truc et puis ceux qui nous avaient stockés dans l’arrière-boutique. Mais grâce à ça, des gens qui avaient de vraies revues comme L’Horizon du Fantastique m’ont contacté. Il n’était pas question d’argent mais de publication. C’était déjà bien car, comme ça, je n’avais plus à me faire chier à tirer. Et puis, le but inavoué de la chose, c’était d’aller dans les services de presse des distributeurs pour leur dire : « Voilà, j’ai une revue et j’aurais besoin de photos de tel film, puis tel film puis tel autre… » Je dois admettre que les mecs, ils étaient tous hypercools. Avec patience, ils me sortaient tout ce qui restait de leurs dossiers et j’ai fait les bases de ma collection de photo comme ça. A l’époque, pour les grosses productions américaines, il y avait des tonnes de photos disponibles. C’était des trucs d’une beauté absolue.

Ça a déterminé votre cinéphilie…
Ca a déterminé mon penchant pour le fantastique dans ma cinéphilie parce que dès que j’ai été en âge d’aller au cinéma tout seul, c’était pour aller voir des films d’épouvante. Bon, à onze ans, je me cachais le visage parce que j’avais très peur mais… C’était toujours le dimanche après-midi dans des salles à peu près vides. C’est un goût que j’ai cultivé et je me suis retrouvé à aller voir tout ce qui était visible à l’époque : Godzilla, les premiers films de la Hammer, etc…
Et qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire sur ce cinéma-là ? Etait-ce un plaisir purement personnel ou vraiment une envie de transmettre un plaisir en faisant découvrir un univers ?
C’était une certaine solitude… Je me sentais bien seul sur ma planète. A l’école, on se foutait de moi parce que j’avais le malheur d’avoir dit que j’étais aller voir Frankenstein s’est échappé, et les autres mômes, comme tous les mômes, étaient très cruels, très moqueurs. C’est toujours pareil aujourd’hui. On se fout de la gueule de mon fils parce qu’il s’est teint les cheveux ou parce qu’il a les cheveux longs… On m’appelait Frankenstein dans mon dos mais moi, contre vents et marées, je continuais mon petit bonhomme de chemin. Puis, j’ai grandi, j’ai commencé à travailler, je me suis marié, j’essayais d’avoir une vie normale mais… Je ne pouvais pas parce que j’étais attiré vers les salles de cinéma. Même à l’âge de vingt-quatre ans où j’aurais du me calmer, je partais tous les soirs pour explorer les salles de quartier de Paris où on passait encore des Raspoutine que j’avais pas vus, des péplums… Parce qu’il faut dire que ma culture, c’est pas que le fantastique. J’étais gros consommateur du cinéma américain comme les westerns, les Robin des Bois, les Lancelot, enfin, tout ce qui passait. A côté de ça, j’éprouvais un fort penchant pour le cinéma de genre italien. A l’époque, c’était la fin du film de cape et d’épée et le début du péplum. Donc je crois que je me suis cogné tous les péplums. Après sont venus les westerns italiens et tout… Mais tout ça n’a jamais entaché ma passion profonde pour le cinéma fantastique. En soixante-dix, c’était une époque un peu charnière de ma vie parce que j’étais marié depuis cinq ou six ans et je m’emmerdais. J’étais vraiment seul dans ma passion du cinéma et puis le grand choc, ça a été de découvrir un fanzine, L’Ecran Fantastique. J’allais à la librairie Brentanno's à Paris pour acheter des comics et là, je tombe sur le numéro deux de L’Ecran Fantastique. C’était la version ronéotypée, pas la version qu’on connaît aujourd’hui. Je l’ai acheté et l’ai lu avec passion. A l’époque, on n’avait qu’une seule revue qui parlait de ça, c’était Midi Minuit Fantastique. Je me suis dit : "Putain, c’est possible ! Voilà un mec qui fait ça tout seul, il voyage, il a des contacts et des correspondants à l’étranger !". Ca a fait son chemin dans ma petite tête puis je me suis aperçu que d’autres fanzines existaient comme Cyclope… Je ne veux pas critiquer parce que toute initiative était bien à l’époque mais c’était moins intéressant que L’Ecran Fantastique qui, lui, donnait des infos. En fait, c’était déjà une vraie revue. Et puis, je me suis dit que moi aussi, j’avais des choses à dire. Je me rappelais des films que j’avais vus. Je me suis dit que j’allais essayer parce que j’était vraiment trop seul. Et en faisant ça, je vais peut-être me faire des amis.
Donc, j’ai fait les bases de ma culture dans les cinémas populaires. Puis j’ai continué avec un goût prononcé pour le cinéma fantastique dû à un traumatisme de première enfance. Mes parents m’ont emmené voir Deux Nigauds contre Frankenstein quand j’avais six ans. C’était un film, à l’époque, interdit aux moins de seize ans mais le directeur de la salle nous a laissé entrer parce que c’était un film comique en fait. Et dès les premières images du film où l’on voit Lon Chaney se transformer en loup-garou, j’ai été terrifié. Je me suis caché dans le gilet de ma mère. Il a fallu qu’on parte au bout d’une heure. Je ne regardais pas mais ne supportais pas ce que j’entendais. Et il y avait la voix de Bela Lugosi qui parlait de "sucer le sang"… Comme ça m’avait bien secoué, j’avais un frère aîné qui passait son temps à découper les Cinémonde, Ciné Revue. Il me mettait les portraits de Frankenstein dans les cahiers d’école…

Alain Petit, vous êtes un personnage culte pour tout amateur de films de genre… Comment vous définiriez-vous pour vous présenter en quelques mots ?
C’est difficile parce que faudrait déjà que j’ai une haute opinion de moi… Disons que j’ai eu la chance de pourvoir défendre les choses que j’aimais. Que se soit à l’écrit ou ailleurs. Mais en fait, c’est sur le tard que c’est arrivé. J’ai toujours été cinéphile, toujours. Je veux dire, mes premiers souvenirs sont cinéphiliques. Mes premiers souvenirs d’enfance, ce sont des scènes de cinéma où j’allais avec mes parents. C’était un rituel : on allait au cinéma le samedi soir quoi qui passe. Ce pouvait être Luis Mariano, Eddie Constantine, Bourvil, Fernandel… Et puis quand j’ai été en âge de sortir avec mon frère aîné, on écumait tous les cinémas de Nanterre. Il y avait cinq salles à Nanterre qui passaient deux films toutes les semaines. Ça faisait un potentiel de dix films par semaine et il était bien rare qu’on ne les voie pas tous. Et puis le dimanche, on bougeait, on allait à la Garenne ou à Putaux. On allait dans toutes les petites villes des environs pour voir des films qui n’étaient pas diffusés à Nanterre.
©Photo Droits Réservés®
Alain Petit dans son antre

Alain Petit est un sacré personnage. Voila trente ans qu’il défend le cinéma de genre avec une incroyable conviction. Il est le premier à avoir défendu le western spaghetti et reste LE spécialiste de Jess Franco, cinéaste qui a eu les récents honneurs d’une rétrospective à la Cinémathèque Française. D’abord dans le fanzinat, puis la télé et aujourd’hui dans des suppléments DVD, il a toujours fait preuve de générosité dans le partage de son savoir. Pourtant, comme il le dit lui-même, Alain Petit est un personnage de l’ombre. C’est pourquoi nous sommes heureux à Culturopoing de donner la parole à un grand défenseur du cinéma que nous aimons. Et c’est chez lui, près d’Avignon, que notre homme nous a accueilli. Entretien mené par Lionel Grenier et Stéphane Pousse (Radio Raje)
Entretien avec Alain Petit - Itinéraire d'un enfant du BIS
Posté par Lionel Grenier le 2009-02-08
©Photo Droits Réservés®
Jean-Pierre Bouyxou en compagnie d'Alain Petit, deux amis de Jean Rollin
29 septembre 2013

Hommage à Jean Rollin, par Jean-Pierre Bouyxou.
Mes trois premiers sont des pue-du-zoom, réunis dans un même mépris par la critique institutionnelle. S’il arrivait qu’on leur concédât un vague talent, c’était pour le minimiser aussitôt, et les accuser de le gâcher par manque d’ambition. Jean Rollin, José Benazeraf et Jess Franco comptaient parmi les cinéastes les plus singuliers de leur génération. C’étaient d’authentiques auteurs : chacun avait ses thèmes de prédilection, son univers et surtout son style, reconnaissable au premier coup d’œil. Mais tous trois préféraient le cinoche, le vrai, celui des salles de quartier, au cinéma pompe-l’air prôné par la culture dominante. Ça ne les empêchait pas, au zénith de leur inspiration, de refuser toute concession au commerce, alors même que leurs films relevaient sans complexe de l’exploitation, sinon de la sexploitation. C’est ce rejet des normes qui a éloigné d’eux bon nombre de bisseux aussi sectaires, à leur façon, que les plus rancis des cinéphiles orthodoxes. Il y a, dans Le Frisson des vampires, dans Le Concerto de la peur, dans Les Expériences érotiques de Frankenstein, des séquences pour lesquelles je donnerais tout Melville et tout Rohmer, parce que j’y trouve un culot, une créativité dont sont foutrement incapables les metteurs en scène policés et virtuoses qui calibrent leurs films comme des charcutiers leurs saucisses.
J’ai passé sur les plateaux de Jean Rollin quelques-uns des moments les plus passionnants de ma vie. J’ai été son assistant, son scénariste, son acteur, et tant pis si j’ai surtout bossé sur ses nanars les moins intéressants, de miteux pornos signés de pseudonymes, qu’il bâclait sans état d’âme. Tourner avec lui était une fête. J’avais fait le figurant dans un de ses « vrais » films, Les Démoniaques, frigoussé dans des conditions dont n’auraient voulu ni Couzinet ni Pécas dans leurs pires jours de dèche, lorsqu’il me demanda d’être son assistant pour sa première réalisation 100% hard, Douces Pénétrations. « Mais, objectai-je, je n’ai aucune compétence technique ! » Il s’en foutait et me le dit : « Aucune importance. Je ne cherche pas un assistant classique mais quelqu’un avec qui je puisse échanger des idées. » C’est ainsi que je devins, pour un temps, à la fois son confident et son collaborateur principal, cumulant les fonctions de conseiller pseudo-artistique, de régisseur, de photographe de plateau, de script boy, de clapman, de régisseur, de rafistoleur de dialogue et de directeur de production, tout en passant de l‘autre côté de la caméra dès qu’il manquait quelqu’un pour tenir un rôle grand ou petit. Mais j’ai aussi eu la chance de participer à plusieurs de ses œuvres maîtresses, dont chaque plan était mûrement prémédité. N’allez pas croire, pour autant, qu’il chiadait ses prises de vue. Il se moquait qu’un travelling soit trembloté ou qu’un acteur joue faux. Il pensait que l’essentiel était ailleurs, et il avait raison. Follement lyriques, ses films charriaient une poésie brute, loin des conventions. Les juger à l’aune du cinéma ordinaire serait aberrant.
José Benazeraf avait, lui, des côtés exaspérants. Mégalo, grande gueule, il n’en troussait pas moins – avant de se perdre, hélas, dans la routine de la vidéo X – des films sidérants d’intelligence et de beauté subversives. Et fabuleusement bandants, en prime. Il avait toutes les audaces, y compris celle de ne tenir aucun compte du public que décontenançaient la fixité de ses plans-séquences, ses ellipses radicales, sa manie des citations. Il fut question, à différentes reprises, que j’écrive un scénario pour lui. Ça ne s’est pas fait. Nous n’avons travaillé qu’une fois ensemble, pour un journal qu’il avait décidé d’éditer à ses frais et dont les autres rédacteurs se nommaient notamment Mustapha Khayati, Noël Godin et Patrice Énard : Show Bzzz, qui s’interrompit après trois numéros.
Un soir, avec Paul-Hervé Mathis, nous avons présenté Benazeraf à Jess Franco. Ils parurent s’entendre parfaitement et envisagèrent même un film en tandem : une adaptation fessue de Médée que l’un, José, aurait produite, et l’autre, Jess, réalisée. Il n’en fut plus jamais question et nous apprîmes le lendemain, à notre stupéfaction, qu’ils s’étaient mutuellement détestés.
Aucun cinéaste ne fut à la fois plus surdoué et plus désinvolte que Franco. Certains de ses films sont des brouillons informes ; d’autres sont époustouflants de splendeur, d’étrangeté. J’avais fait sa connaissance dans un studio pouilleux, à Bruxelles, où il terminait – sans la moindre équipe technique – le tournage de deux films en même temps : La Comtesse noire et Les Nuits brûlantes de Linda. « Je vais ajouter un rôle pour toi dans un des films, m’avait-il annoncé au bout d’une heure de bavardage. Ainsi fut fait. Il écrivit un bout de dialogue et je devins dans La Comtesse noire le fils du Dr Orloff, un occultiste aveugle non prévu dans le scénario. Le plus étonnant, à la vision du film, c’est que les deux scènes improvisées pour moi, ajoutées au dernier instants et réalisées en un clin d’œil, semblent absolument indispensables : on a l’impression que l’histoire, sans elles, n’aurait ni queue ni tête. À peine les avait-il tournées que Franco, avisant une statue d’éphèbe grandeur nature dans un coin du studio, en entreprit une autre, en plan unique : il demanda à Lina Romay, pas encore sa compagne mais déjà sa muse, de se livrer toute nue à une danse lascive en se frottant à l’Apollon de plâtre. Pas de musique, rien. Il indiquait à Lina chaque geste qu’elle devait faire. On crevait de froid, il n’y avait pas d’autre bruit que le ronron de la caméra et cette voix qui, monocorde, marmonnait des ordres en espagnol. « Dans lequel des deux films vas-tu mettre ça ? » ai-je demandé. Jess a ri doucement. « Personne ne le sait, m’expliqua-t-il, mais j’en tourne aussi un troisième en même temps. Je le produis tout seul, sans avoir à payer la pellicule ni les comédiens. » Ses deux producteurs, Marius Lesœur et Pierre Quérut, aussi pingres l’un que l’autre, et tous deux présents, n’y avaient vu que du feu.
Mon suivant est un peu le quatrième mousquetaire de la bande. Après avoir mené une renversante carrière d’acteur à tous les vents des genres populaires, y compris chez Benazeraf et Franco, Michel Lemoine venait, au moment de notre rencontre, de faire ses débuts de réalisateur. Désarmant de sincérité, son premier film, Les Désaxées, était riche de promesses que l’avenir, en le confinant contre son gré dans le porno de série, n’allait pas lui permettre de tenir. Il avait, par générosité, accepté de revenir à son ancien métier et, sans demander un centime de cachet, de tenir le rôle-titre de ce qui aurait dû être mon premier long métrage, un Frankenstein de série Z. Sans cesse ajourné, le projet finit, comme tant d’autres, par capoter. Michel s’en montra très contrarié. Il eût été, avec son regard halluciné, un parfait savant fou près de sa femme d’alors, la sculpturale Janine Reynaud, en monstresse féline.
Mes deux derniers sont cent fois moins connus que les précédents. Ils œuvraient dans un domaine beaucoup plus confidentiel, l’avant-garde, l’underground. Aussi, sans doute ignorez-vous tout d’Étienne O’Leary et de Philipe Bordier (avec, il y tenait, un seul p à son prénom). Étienne joua dans un de mes courts métrages. J’apparus dans le dernier des siens, Chromo Sud. La quintessence du psychédélisme, une incandescence d’images. Je perdis sa trace dans la pagaille de Mai 68. Avait-il regagné son Canada natal ? Aucun de ses amis n’avait de nouvelles, ses films avaient disparu. Après bien des recherches, ils furent retrouvés à la cinémathèque du Québec, dans des boîtes rouillées que personne n’avait eu la curiosité d’ouvrir. Je suis allé les présenter à Montréal en 2010. Et j’ai revu Étienne, pensionnaire depuis plus de quatre décennies d’un établissement psychiatrique. Enfermé, surtout, dans la schizophrénie. Assis incognito au dernier rang des spectateurs subjugués, il a probablement vécu, ce soir-là, ses ultimes minutes de bonheur. Philipe, lui, faisait des films qui, à la même époque que ceux d’Étienne, se situaient à leurs antipodes. Austères, magnifiques. Il était un de mes plus vieux amis. Nous avons fait mille choses ensemble. Pendant vingt longues années, il s’est battu contre le cancer. Je l’ai vu pour la dernière fois dans une chambre d’hôpital. Déjà dans le coma, il s’est soudain dressé sur son lit et, rejetant le drap, a tenté de se lever. Ses yeux qui ne me voyaient pas étincelaient de colère, de haine, de révolte contre la camarde à qui il refusait se s’abandonner. L’infirmière, appelée en hâte, lui administra une dose de morphine qui le fit s’endormir. Il n’allait plus jamais se réveiller.
Jean Rollin est mort le 15 décembre 2010. Étienne O’Leary, le 17 octobre 2011. José Benazeraf, le 1er décembre 2012. Philipe Bordier, le 7 janvier 2013. Jess Franco, le 2 avril 2013. Michel Lemoine, le 27 juillet 2013. Ce texte est un humble salut à leur mémoire.
G-E6NH8JM7S2


sur le site officiel français dédié à
Jean Rollin, cinéaste-écrivain
03 novembre 1938 - 15 décembre 2010