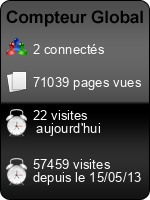©Photo : Véronique D.Travers®




























Arte Tracks 2005 (Source YouTube)
Jean Rollin
Entretien avec Jean Rollin
Entretien avec
Jean Rollin
Par Jean Depelley & Etienne Barillier
Slash : Vos films viennent de sortir en DVD aux USA... Comment est-ce que vous expliquez cette reconnaissance outre-Atlantique alors que ces films ne sont pas vraiment disponibles en France ?
Jean Rollin : Il se trouve que dans les pays anglo-saxons, je suis beaucoup plus reconnu qu'en France. Je suis moi-même tout à fait étonné de cela. J'étais assez surpris de recevoir des magasines américains dans lesquels j'avais une place. Là où je me suis rendu compte que j'avais un public c'est quand je suis allé à New York. Nous sommes allés l'année dernière à une convention du film fantastique et j'ai été stupéfait de voir des queues interminables de gens pour des autographes. On avait amené des affichettes et des bouquins et dès la première soirée tout a été vendu... Tous les gens qui venaient à cette convention savaient qui j'étais. J'étais très, très surpris. En Angleterre aussi, on a un public absolument énorme, alors qu'en France pas du tout…
S : La France vous boude-t-elle ?
J.R. : Ce n'est pas qu'elle me boude : elle m'ignore. Ceci dit, il y a un petit noyau d'amateurs du fantastique, mais le fantastique, ce n'est pas ce qui plaît en France.
S : Est-ce pour cela que vous avez recadré votre activité sur des collections littéraires ?
J.R. : Ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que j'ai été très malade et obligé de suivre un traitement à l'hôpital tous les deux jours – j’y suis encore obligé d'ailleurs. J'étais sous dialyse. Pendant quatre heures, on est assis sur un lit et on ne peut rien faire. Alors j'ai acquis un Macintosh et puis j'écrivais mes livres. J’ai pratiquement écrit tous mes livres à l'hôpital, pour me pas perdre mon temps ! (rires)
S : Quand on regarde les fiches techniques de vos films, des noms reviennent souvent comme Sam Selsky, Brigitte Lahaie... On a l'impression que vos films sont des entreprises familiales.
J.R. : C'est un peu ça. Sam Selsky était ce qu'on appelle un américain de Paris, un américain qui vivait à Paris. On a sympathisé et il m'a fait faire mon premier film. Une solide amitié nous a liés. Sam Selsky est un peu comme mon père adoptif. Il m'a beaucoup appris et m'a produit plusieurs films. Il était même dans l'avant-dernier, Les deux orphelines vampires (1995). Il nous a quittés, il est mort maintenant. Je garde un souvenir très ému de Sam Selsky. Non seulement parce qu’il m'a fait faire mon premier livre, mais aussi parce qu’il m'a permis de sortir mon deuxième roman chez Fillipachi. Il m'a aidé tant qu'il a vécu. C'était quelqu'un de très, très bien. Quant à Brigitte Lahaie, je lui ai fait faire son premier film non porno, Les Raisins de la mort (1978). C'était une rencontre assez agréable... D'abord parce qu'elle était très belle. Elle arrivait en haut des marches d'une maison en ruine avec ses chiens, elle laissait tomber sa robe et apparaissait nue dans ce décor de village abandonné. On avait fait un hommage à Barbara Steele dans Le Masque du Démon (Mario Bava, 1960) avec ce plan. Les gens faisaient "ha..." dans la salle. On aurait dit une statue, ce corps blanc, comme ça dans la nuit. Simplement pour la petite histoire, c'était sur le Causse et il faisait très froid... Il n'y a pas un bistrot ou quoi que ce soit d'ouvert à moins de cinquante kilomètres. Nous étions donc dans ce village abandonné à tous les vents. Elle avait une phrase à dire mais elle avait tellement froid qu'elle ouvrait la bouche pour parler et qu'elle ne pouvait pas sortir un mot tellement elle tremblait de tous ses membres. Je ne sais pas combien on a fait de prises sur ce plan abominable... c'était un plan maudit ! Après la caméra ne voulait plus tourner à vingt-quatre images/seconde parce qu'elle était gelée. Alors il a fallu l'entourer de coton. C'était terrible…
S : Est-ce que vous fréquentiez la mythique libraire Le Kiosque de Jean Boullet, rue du Château ?
J.R. : Jean Boullet était un ami, un érudit. C'était un personnage un peu particulier, un homosexuel qui ne se cachait pas, qui aimait un peu tout ce qui était monstrueux, louche, bizarre. Il avait un jeune amant qui travaillait dans sa librairie, qui devait avoir seize ou dix-sept ans et qui avait un bras atrophié ! Habillé entièrement de cuir noir, il entretenait avec lui des rapports un peu sado-maso. Mais il était très gentil... Il faisait malgré tout un peu peur. (rire) Jean Boullet était devenu un spécialiste de la B.D. C'était le début de la reconnaissance de la bande dessinée. Il y avait le “Club des Bandes Dessinées” de Francis Lacassin dans lequel j'étais. Boullet a sauté là-dessus et ramassait des bandes dessinées partout. On trouvait des choses étonnantes chez lui…
S : Cette époque de Saint-Germain des Prés, du Jazz, ne vous aurait-elle pas inspiré l’écriture quasi automatique de vos films ?
J.R. : Ça faisait parti de notre environnement. Je fais parti d'une génération qui a été influencée par le surréalisme, par les frères Prévert que j'ai bien connus. Je n’ai pourtant pas connu Boris Vian. Pour nous c'était naturel de rencontrer des gens comme ça. Tout cela fait parti d'un ensemble où inconsciemment, on subissait une influence, une certaine orientation dans ce que l'on faisait…
S : Comment avez-vous découvert le Serial, le cinéma “bis” ?
J.R. : Quand j'étais gamin, à douze-quatorze ans, le serial n'existait déjà plus. Mais il y avait des serials condensés en deux épisodes ou plutôt, comme on disait, en deux époques d'une heure et demie. On allait voir la première époque de Zorro et ses légionnaires (William Witney, 1939) et puis on attendait la langue pendante la semaine suivante pour aller voir la suite. Il y avait encore Le dernier des fédérés (The Lone Ranger, W. Witney, 1938), Les trois diables rouges (W. Witney, 1939), "les grands fantastiques" avec Le Mystérieux docteur Satan (W. Witney, 1940). J'étais nourri de ça. Il y avait à cette époque-là dans les gares une chaîne de cinémas qui s'appelait Cinéac. C’étaient de toutes petites salles et l’entrée ne coûtait presque rien - un Franc ou deux de l'époque - et les gens venaient passer une demi-heure ou trois-quarts d'heure en attendant leur train ou leur changement de train. Il y avait sans arrêt des gens qui venaient ou qui partaient. Ils passaient des films courts, des épisodes de serial. C'était le dernier endroit à Paris où on pouvait voir ça. Et on entendait les trains qui partaient, on entendait les annonces. C'était complètement surréaliste comme endroit. J'ai hanté les Cinéacs pendant toute mon enfance. On y allait en sortant de l'école. J'ai vu des choses maintenant rarissimes et tout à fait étonnantes. J'ai vu Tom Mix dans L'oiseau de fer (The miracle rider, Armand Schaefer, 1935), un film de science-fiction avec des indiens ou encore Les exploits de Rintintin, le chien loup(The Lightning Warrior, Benjamin Kline, 1931), tout un tas de trucs dont parfois on ratait la suite parce qu'on ne pouvait pas y aller à chaque coup. On restait donc sur sa faim, alors on en voyait d'autres… J'ai été élevé là-dedans. Je n'avais pas la télé à cette époque-là. On vivait les serials, les films d'aventures et les bandes dessinées. Tout ça évidemment avait un point commun qui n'existe plus maintenant : c'est que c'était à suivre. C'était pour l'esprit un stimulant, une excitation tout à fait extraordinaire. Comme nous étions obligés d'attendre une semaine voire quinze jours pour voir la suite, nous ne pouvions pas supporter de ne pas savoir ce qui allait se passer. Alors on allait dans les terrains vagues et on jouait à Mandrake le Magicien, à Flash Gordon et on inventait la suite de ce que l'on avait vu. Tout ça s’est passé pour moi aux alentours de l'ancienne gare Montparnasse où il y avait ce cinéac. J'allais au lycée Buffon qui était à deux pas. J'habitais rue de Vaugirard juste en face. Là il y avait un des derniers terrains vagues, du côté de la rue Vercingétorix. C'est la clef de ce que je suis. J'ai essayé de retrouver ça dans un de mes derniers livres, Monseigneur rat (Sortilège, 1998) qui est entièrement bâti là-dessus : c'est la souvenance de ces bandes dessinées d'enfants...
S : Venons-en à votre collaboration à la revue mythique Midi-Minuit Fantastique et à votre amour de la littérature populaire française...
J.R. : Gaston Leroux naturellement ! (rires) Nous aimions particulièrement les phrases en italiques. Des phrases en italiques qui, isolées du contexte, étaient des phrases surréalistes, totalement étonnantes. Dans La reine du Sabbat, je me souviens : "On assassine ce soir à l'arme blanche". Dans le livre, il y a une explication... mais, tout à coup, une phrase comme cela, c'est formidable. C'est un petit peu le pendant du film Orphée de Cocteau (1950), si vous voulez. Dans le film, Jean Marais écoute d'étranges messages à la radio, des messages de l'autre monde. Ce sont des phrases qui proviennent certainement des phrases que la Résistance émettait sur Radio Londres, des phrases codées qui, toutes seules, faisaient des espèces de phrases poétiques. Il y avait une poésie…
S : Comment êtes-vous passé de l'écrit à l'image ?
J.R. : C'est un peu le contraire. J'ai fait d'abord les films et les livres ensuite ! J'ai toujours aimé écrire. Je voue une reconnaissance éternelle à ma mère qui, quand j'avais seize ans, m'a offert ma première machine à écrire. J'étais un très mauvais élève. On ne savait pas ce que je deviendrai. Il n'y avait que le cinéma qui m'intéressait et quand j'en parlais à ma famille, elle poussait de grands cris ! Au moins, s’il sait taper à la machine, il se débrouillera toujours… J'ai donc appris à taper tout seul avec une vieille Jappy portative. Je suis arrivé à une certaine virtuosité, même avec deux doigts ! J'ai eu la passion d'écrire. Je ne m'imaginais pas capable d'écrire un livre mais j'ai fait quantité de scénarios qui n'ont jamais été filmés.
S : On retrouve fréquemment des thèmes forts dans vos films : le vampirisme, l'érotisme, plus exactement le lesbianisme. Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans ?
J.R. : Ce n'est pas le lesbianisme en soi, dont je me fiche complètement. C'est le fait que ce soient des femmes. J'adore filmer les femmes. Je filme très volontiers une scène d'amour entre deux femmes, alors que lorsqu'il y a un mec, cela me défrise un peu… Je n'ai pas de vocation pour filmer des corps d'hommes, alors que des corps de femmes, cela me stimule beaucoup. Il y a dans Fascination (1979) une scène d'amour entre deux femmes que je trouve belle, pas du tout excitante, mais jolie, avec deux femmes très jolies, Brigitte Lahaie et Franka Mai. Elles l'ont réellement jouée avec tendresse et non pas d'une façon graveleuse. J'ai été très influencé par la peinture, les peintres surréalistes bien sûr. Il y avait Paul Delvaux, un peintre belge qui me fascinait beaucoup. Paul Delvaux a toujours peint des gares dans la lignée d'un Magritte. Il les peignait d'une façon très réaliste avec, entre les rails, une femme nue! Il les sortait d'un contexte normal pour les placer dans un contexte inhabituel, ce qui donnait effectivement son surréalisme. Il y a d’ailleurs un film d'Henri Storck (cinéaste documentaire belge des années 30) sur Paul Delvaux que j'ai vu. J'ai été fasciné par le choc poétique qu’il pouvait produire en mettant une femme nue, hiératique et immobile, dans un endroit du quotidien. J'ai essayé de refaire ça au cinéma… Il fallait un peu d'érotisme parce que sinon les films ne seraient pas sortis. J'ai choisi de mettre cet érotisme-là : des femmes nues pour contenter les distributeurs, mais mises ailleurs que dans un lit ! J'avais envie de faire du fantastique. De tous les personnages mythiques du fantastique, le vampire est le seul qui soit proche de l'être humain. C'est un être humain normal à part les dents, et peut-être un costume, la grande cape… La morsure, c'est le baiser du vampire. C'est aussi un symbole érotique. Alors que le loup-garou, la momie, etc. sont des personnages monstrueux auxquels je ne pouvais pas m'intéresser comme je m'intéressais au vampire. Le vampire pouvait aussi être “une” vampire. Ce qui pour moi prenait une valeur décuplée, alors qu'une loup-garou, je ne voyais pas très bien cela ! (rires).
S : Le mythe de Lilith revisité ? J.R. : oui.
S : Votre premier film distribué, Le Viol du vampire (1968), est paraît-il une suite à Dead Man Walk (Sam Newfield, 1943)...
J.R. : Première nouvelle ! En fait, à l'époque j'étais ami avec un distributeur, Jean Lavie. Il avait acheté, avec Simone Lancelot directrice du Scarlet, un film de vampire de Sam Newfield qui s'appelait Le vampire, créature du diable. Ils ont fait l'erreur d'acheter le film sans le voir. Le film faisait seulement une heure cinq parce que c'était un film pour la double programmation aux Etats-Unis. Ils voulaient récupérer leurs sous et sortir le film. Jean Lavie savait que j'étais passionné par ce genre de choses et m’a dit "tu veux faire du cinéma, tu n'as jamais fait de films très longs. Si tu trouves le financement, moi je te garantis une sortie. Il me faut un film d'une demi-heure, si ce n'est trente-cinq minutes, pour aller avec un film de vampires américain. Je te signe un contrat de distribution." Quand j'ai eu le contrat de distribution, je suis allé voir Sam Selsky. Je lui ai dis qu'on avait un distributeur, une sortie garantie dans quatre salles (le Scarlet, le Cinévox-Saint-Lazare qui marchait avec, Midi-Minuit naturellement, cinéma mythique s'il en fut et le Styx qui venait d'ouvrir dans le quartier latin). Il a réuni deux cent milles francs. Il a fallu tourner avec cette somme. Je n'avais jamais tourné. Le viol du vampire est en fait un film d'amateur. J'ai réuni une équipe, en vérité une équipe de copains. C’était le premier film pour tout le monde. Tous les acteurs n'avaient jamais joué au cinéma. On a trouvé un vieux château qu'il a fallu un peu meubler. Et puis, on a écrit une petite histoire et on a commencé à filmer avec enthousiasme. Au bout de deux jours, j'avais perdu le script dont on n'avait qu'un seul exemplaire évidemment ! Il a fallu continuer en improvisant. Une fois fini, on l'a monté allègrement et on est arrivé à quarante minutes. On met de tout dans un premier film : il y avait de l'érotisme, des vampires, de la violence... Sam Selsky l'a vu et a dit qu'il n'était plus question de le donner pour le sortir en double programme avec Le vampire, créature du diable. "On a fait quarante minutes avec vingt millions, si je retrouve vingt millions, on refait quarante minutes et on a un long métrage !" Il a retrouvé vingt millions, il en a même trouvé trente. Et la deuxième partie a coûté trente millions. Ce qui fait que tout le film a coûté cinq cents mille balles !. Il fallait écrire une suite. Le problème, c'est que tous les personnages étaient morts à la fin de la première partie ! (rire) J'ai donc inventé une Reine des Vampires qui a ressuscité tout le monde! S : Il y a une ambiance très Feuillade.
J.R. : C'est complètement serial… Le film a fait un scandale épouvantable. La police a dû évacuer le Scarlet tellement les gens faisaient du scandale ! Le scandale aidant, ça a été un gros succès. Maintenant c'est une espèce de classique, de film culte. Il est repassé près de trente ans après à la Cinémathèque pour une projection spéciale. La salle était pleine et j'ai vu pour la première fois de ma vie Le viol du vampire dans une salle silencieuse, sans un bruit. Après, il y avait un débat et les gens étaient très contents. Un monsieur a dit "j'ai été voir Le viol du vampire il y a trente ans quand il est sorti. J'aimais bien mais je n'avais rien compris. Je suis revenu aujourd'hui, je n'ai toujours rien compris mais j'aime encore bien" (rires).
S : Vous ne faites pas un cinéma d'effets, qui cherche à secouer le spectateur mais un cinéma d'ambiance. Comment est-ce que vous la pensez, comment est-ce que vous filmez ?
J.R. : Je ne prépare pas l’ambiance et je ne pense pas. C'est tout à fait inconscient. Je ne fais plus de découpage depuis des années. J'ai simplement le scénario dialogué. Quand j'arrive sur le lieu de tournage, j'ai juste quelques minutes devant moi avant de donner mes directives. La première chose qui conditionne tout le reste, c'est la place de la caméra de façon à ce que le chef opérateur puisse faire la lumière, que les acteurs sachent où ils vont jouer et puissent répéter. J'arrive toujours le premier dans un décor pour m'en imprégner durant trois ou quatre minutes. Là il y a - je ne sais pas comment on peut appeler cela - peut-être de l'inspiration… Mais tout d'un coup, une atmosphère, une continuité de plans s'imposent à moi toutes seules. Tout de suite je repère un angle et tout s'enchaîne. Quand on a trouvé la première place de la caméra, la place suivante vient toute seule. Mais il y a cette espèce de magie qui fait que quand on aborde un lieu, avant de commencer à y travailler, il y a une espèce de... quelque chose qui se passe entre le lieu et moi... et peut-être que cela transparaît dans le film…
S : Le cadre s'impose. On a pourtant l'impression que tout est minutieusement cadré alors qu'en fait c'est spontané...
J.R. : C’est spontané. Là où c'est le plus intéressant, c'est quand on filme de nuit. Il y a toujours dans le décor quelque chose en trop, quelque chose que l'on n’a pas envie de montrer. De jour, il faut trouver des angles souvent compliqués, tandis que la nuit il suffit de ne pas éclairer.
S : On pense à la scène de l'aveugle qui apparaît au milieu des morts-vivants dans Les Raisins de la mort (1978)...
J.R. : Elle fut assez longue à préparer parce que, dès qu'il y a de la figuration - en général, des acteurs non professionnels - il y a un travail préparatoire important. Mais le plan lui-même est venu tout seul.
S : Votre narration comporte des lenteurs ou des raccourcis. Le temps ne s'écoule pas avec une vitesse uniforme. Est-ce que c'est un procédé que vous cherchez pour son effet sur le spectateur ?
J.R. : Ce sont des choses qui me sont imposées. On a très peu de temps pour tourner. Ce sont des films très bon marché, il faut aller à l'essentiel. Quand il y a une scène dans laquelle il se passe quelque chose auquel je tiens, j'ai tendance à m'y attarder, à rajouter des plans, etc. Quand il y a une scène qui est indispensable pour la compréhension du film mais qui m'embête un peu, je la bâcle (rire). Pour moi, une scène de dialogue qui fait avancer l'action, qui explique des choses, plutôt elle est finie, mieux c'est. Par contre, quand il y a des déplacements dans un décor, dans un lieu, ce sont des scènes qui m'intéressent et je rajoute des plans. Pour la scène de l'aveugle avec les gens qui apparaissent dans Les raisins de la mort, dans le scénario était juste indiqué "l'aveugle avance et les morts-vivant viennent autour d'elle". Quand la scène se matérialise, quand on la voit avec ses yeux, on rajoute des gros plans de morts-vivants, des gros plans de la fille. Il y a toute une mise en scène qui se met en place toute seule.
S : Il existe une cohérence, avec notamment la plage de Dieppe. Elle semble jouer un rôle récurrent. Est-ce que c'est conscient ?
J.R. : C'est conscient… J'avais dix-sept ans quand je suis parti en vacances à Tourville avec ma mère. J'ai été complètement fasciné par cet endroit, qui n'est, bien sûr, malheureusement plus comme il était. Il y avait des galets blancs, la falaise elle-même très crayeuse, avec ses trous dans la paroi et ces poteaux, nettement plus importants à l'époque que maintenant. C'est une plage extrêmement curieuse. À cette époque, je me suis dis que si j'avais un jour la chance de faire un film, j'aimerais qu'il soit situé là parce qu'il y a tellement de choses à montrer... Un personnage qui passe est simplement enrichi par cet entourage, et si c'est une femme nue, c'est encore plus beau !
S : D'où l'idée d'en faire cette espèce de porte d'accès vers le monde parallèle des vampires ?
J.R. : Oui... J'ai gardé en mémoire cet endroit, jusqu'au jour où j'ai eu la possibilité de faire des films et de les situer là.
S : L’utilisation du lieu dans La Rose de fer a de quoi surprendre... Il n’y a pas d’explications. Dans Les Démoniaques (1973), on voit un personnage surgir de cette plage... Il est nécessaire de voir l'ensemble de l’œuvre pour comprendre sa cohérence...
J.R. : S'il fallait tout expliquer, cela ferait des films de quatre heures et qui seraient très ennuyeux ! (rires) Rien ne prouve que le cimetière de La Rose de fer n'est pas au bord de la mer. Pourquoi pas ? Si j'avais eu les moyens, j'aurai voulu qu'à un moment donné, il y ait une grande marée et qu'elle envahisse le cimetière. Je rêvais de voir la mer commencer à arriver sur les tombes et grimper… Mais bon... c'était une vue de l'esprit, mais c'était tellement beau ! (rire) De même, on a filmé dans un cimetière de locomotives pour le générique, avec toutes ces vieilles locomotives à vapeur les unes derrières les autres. Je voulais - et on a failli le faire, d’ailleurs - en faire transporter une dans le cimetière, pour qu'il y ait une locomotive qui soit une espèce de tombe d'un chef de gare ou n'importe quoi ! (rires) L'idée d'une locomotive à vapeur dans un cimetière était intéressante, mais cela aurait coûté une fortune. Dans Requiem pour un vampire (1971), j'avais rêvé d’avoir Louise Dhour qui jouait du piano dans un cimetière et je voulais qu'il y ait un piano à queue dans le cimetière… Cela a coûté une fortune mais ça je l'ai fait. Cependant, je n'ai pas pu avoir ma locomotive !
S : Vous devez être ami de tous les gardiens de cimetière de France !
J.R. : Surtout ceux de ***. Pour pouvoir tourner tranquillement, on commençait par aller les voir avec deux bouteilles et puis on avait la paix !
S : Le cimetière fait parti des lieux où le symbolisme est le plus important. Est-ce que c'est volontaire ? On pense à la visite du clown de La Rose de Fer…
J.R. : C'est venu sur le moment… Le clown est une référence au film d'avant (Requiem pour un Vampire). J'aimais bien à cette époque-là faire une référence au film que j'avais fait avant, comme une suite, un film dans le film. Il y a là le clown qui vient déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de l'autre clown, celui de Requiem pour un vampire.
S : Est-ce que vous pouvez nous parler de la Griffe d'Horus, votre projet de film de 1990 mettant en scène le détective Harry Dickson ? J.R. : Tout le monde m'en parle ! Un jour Gérard Dôle est venu me voir et m'a dit “Ecoutez, pour moi vous êtes le seul cinéaste qui puisse faire Harry Dickson !”. J'ai bondi là-dessus car c'est tout à fait mon domaine, mon univers, Harry Dickson. Il y avait des rééditions en cours et Corps 9 rééditait les Harry Dickson qui n'étaient pas de Jean Ray. Comme il y avait des problèmes de droits d'auteur, je me suis dit qu'en prenant les Harry Dickson qui ne sont pas de Jean Ray, j’étais tranquille. Mais il me fallait l'accord de Corps 9. Je suis donc allé voir ces gens qui étaient en province et ils m'ont dit qu'eux vivants, jamais je ne ferai Harry Dickson. Ils me détestaient, ainsi que tout ce que je faisais! (rires) Gérard Dôle était furieux et on s’est dit que l'on se passerait de leur accord pour faire Harry Dickson. Il avait écrit La Griffe d'Horus. On a fait des essais avec Jean-Michel Nicollet (le peintre des couvertures de livres de la collection Néo). Nicollet était tellement le personnage que forcément ça collait. Il n'avait jamais tourné, il avait un problème de diction et ne parlait pas très juste, mais en deux ou trois séances de travail, cela se serait arrangé et il bougeait très bien… On a fait trois minutes avec lui et sa copine (l’artiste Kelek), qui faisait une espèce de monstre qui sortait de l'eau. C'était très amusant. Ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de suite.
S : Quelle est sa durée ?
J.R. : Trois minutes…
S : Est-ce que ça ressemble visuellement au travail de Nicollet sur le roman-photo “Harry Dickson” sorti chez Crapule(1987) ?
J.R. : Oui, c'est un petit peu ça... Il y a deux décors. L'appartement d'Harry Dickson, c’était l’appartement d’un copain, un truc sous les toits, que Gérard Dôle s'était amusé à meubler en deux heures avec minutie. Il avait placé plein de petits objets de style anglais qu'on ne voit pas à l'écran, mais on avait l'impression de se trouver chez Harry Dickson. Il avait trouvé un Tom Wills, un inspecteur Goodfield qui étaient tous les deux très, très bien. Et tout ça, en costumes d'époque! On a tourné une petite scène où Harry Dickson parle de la Griffe d'Horus, dit un très bon texte de Gérard Dôle, ils prennent manteaux et revolvers et partent pour voir une monstruosité qui terrorise la City. Là, on a le deuxième décor, les bandits qu'Harry Dickson réussit à mettre en fuite sur les quais de la Seine. À un moment donné, il y a une espèce de monstre qui sort de la Seine - la copine de Dôle avec un collant noir et un masque de coq ayant servi dans La vampire nue - puis la chose est poursuivie par Harry Dickson et tout d'un coup elle disparaît. Ça s'arrête là. Ce ne sont que des extraits qui n'étaient pas destinés à être montrés.
S : Quel dommage... Vous sentez-vous plus proche du Jean Ray d'Harry Dickson ou de celui de “Malpertuis” et de "La Ruelle ténébreuse" ?
J.R. : Je pense que mon univers, c'est plus Harry Dickson, plus le feuilleton… J'aimerais beaucoup travailler avec Gérard Dôle de manière suivie parce que c'est quelqu'un qui, je pense, est très proche de moi.
S : Il y a un renouveau du serial dans l'air du temps. Pourquoi est-ce que la télévision ne produirait-elle pas un feuilleton de ce type?
J.R. : Elle l'a fait à l'époque à laquelle elle était encore quelque chose… Elle a fait la série Rocambole qui était très, très bien (3 saisons entre 1964-65 dues à Jean-Pierre Decourt). Il y a eu le film de Pierre Prévert, Les Compagnons du Baal (1968) et L'homme sans visage de Franju (1975) ou encore L'île aux trente cercueils (M. Cravenne, 1978). Tout cela à la grande époque… Cela laissait supposer que la télé allait devenir quelque chose de formidable… Maintenant, ils ne font plus que de... oublions ce qu'ils font ! C'est à mon avis cela la vocation de la télévision : le film à épisodes. Ils ont perdu ça, tant pis pour eux…
S : Vous avez également œuvré pour la bande dessinée avec La Saga de Xam (1967), en collaboration avec Deville. Il y avait même une loupe dans le tirage original…
J.R. : Nicolas Deville était très minutieux et miniaturisait ses BD. Je faisais le scénario et la mise en page. Je lui dessinais des planches avec des cases de différentes formes. À un moment donné, nous nous sommes dit que nous allions faire une mini BD. Mais lui aimait bien quand il y a beaucoup de texte... C'était devenu illisible. L’éditeur Losfeld a eu l'idée de rajouter sur les premiers tirages cette petite loupe en carton pour pouvoir lire les textes (rires).
S : Vous avez été proche de Philippe Druillet que vous avez fait tourner dans Le Viol du Vampire...
J.R. : C’est mon premier affichiste.
S : Avez-vous des projets en BD ?
J.R. : J'aurais bien voulu faire une adaptation en BD de mes Deux orphelines vampires, les cinq petits volumes chez Fleuve Noir qui sont épuisés maintenant. Je me suis adressé à Pierre Dubois qui traîne dans le milieu de la BD et lui ai demandé de me trouver un jeune dessinateur. Il m'en a envoyé une dizaine et j'ai le regret de dire que pas un seul ne me convenait : ou c'était totalement caricatural ou un démarquage de Rahan. Je n'ai pas trouvé la personnalité qui pourrait faire Les deux orphelines... Enfin, c'est toujours dans l'air du temps…
S : Et votre période Porno, on ne peut pas l'édulcorer... Quelle était votre démarche, le but qui vous a animé ?
J.R. : Le but était simple : faire du fric ! Quand le Porno est arrivé en France, ce fut une catastrophe épouvantable car toutes les salles où l’on pouvait passer mes films se sont converties en salles porno ! Il n'y avait plus moyen de sortir un film. Il fallait bien gagner sa vie. Je me suis bien amusé en faisant mes pornos. Je ne renie en rien cette période-là. Quand le porno est retombé un petit peu en salle à cause de la vidéo, on s'est remis à faire du fantastique. Je me suis bien amusé. Si on fait ça avec humour, ça passe très bien…
S : Vous avez remis cela en 1994 pour Marc Dorcel avec Le Parfum de Mathilde, un film qui sortait de sa production habituelle... Avez-vous d'autres projets analogues ?
J.R. : Je n'ai pas d'autres projets. Dorcel travaillait avec le réalisateur Michel Ricaud qui est mort accidentellement. Il fallait que quelqu'un prenne la suite. Tous les réalisateurs de X se sont mis à faire la queue chez Marc Dorcel pour être engagés. Il a eu envie de faire une expérience, comme tout le monde l'attendait au tournant. Il a donc décidé de faire un Jean Rollin. Effectivement, ça a marché…
S : Vous êtes aussi acteur de série Z pour le libraire-réalisateur Norbert Moutier. On vous voit dans plusieurs de ses films : Trépanator (1990), Alien Platoon (1992) ou Dinosaur from the deep (1993). Ça vous amuse ?
J.R. : C'est un vieux copain... Il y a une école amateur de films fantastiques qui semble assez importante. Pleins de réalisateurs m'ont demandé de tourner pour eux, mais pour des rôles en général sans intérêts, certainement pour mettre Jean Rollin dans le générique. Pour que je fasse un rôle comme cela, il faut que le rôle m'amuse ! Norbert m'amuse, lui. Il fait ça avec un grand sérieux et il ne comprend pas pourquoi les gens rient dans ses films. J'étais comme ça quand j'étais jeune. Quand j'ai fait Le viol du vampire, j'ai vu des salles hurler de rire et je ne comprenais pas pourquoi, parce que pour moi c'était sérieux (rires)… Je trouve très admirable que Norbert, qui n'est pas un intellectuel, qui n'a pas eu une enfance riche et était obligé de mendier des sous pour aller au cinéma, ait réalisé son rêve d'enfant de faire des films. Ils sont ce qu'ils sont, mais c'est assez admirable de voir quelqu'un qui s'obstine comme cela jusqu'à réaliser son rêve sans argent...[***] Il n'a pas d'autres possibilités pour réaliser un film que d’utiliser les moyens du bord... Quel personnage ! J'ai tourné dans un long métrage qu'il a entièrement fait dans sa cave ! Norbert est une des rares personnes qui peut me demander de tourner pour lui quand il veut.
S : Pouvez-vous donner quelques informations sur votre nouvelle production La Fiancée de Dracula ?
J.R. : On me demandait pourquoi je ne faisais pas de Dracula, alors que dans le fantastique, c'est tout de même le personnage qui fait recette. Renseignements pris, il n'y avait pas de droits sur Dracula. On peut l'utiliser à condition qu'il n'y ait pas le nom tout seul. Je n'avais pas le droit d'appeler un film Dracula, mais je pouvais l'appeler Le Retour de Dracula... On lui a donné une fiancée... et puis on a tourné... J'aurais aimé le tourner en Ecosse mais je n'ai pas pu. On l'a par contre présenté au Festival d'Edimburgh. J'espère tourner le prochain en Ecosse. C'est grâce à Canal+ et à Jean-Pierre Dionnet que ce film a vu le jour. La chaîne va nous le prendre. On sait d'avance combien on va toucher, on a donc pu faire un plan de trésorerie qui tient debout et ne pas avoir de dettes...
S : On entend parler d'un nouveau projet, un huis-clos dans le théâtre du Grand-Guignol ?
J.R. : [coupure] Je suis un inconditionnel du Grand Guignol, mais je sais qu'on ne peut plus utiliser le théâtre de la rue C**. Faire ça ailleurs, cela n'aurait pas grand intérêt. La salle a été complètement refaite par un imbécile qui l'a transformée en théâtre 347, qui a supprimé toutes les boiseries, les angelots qui restaient de cette petite chapelle, qui a tout cassé… J'ai tourné sur la scène du Grand Guignol une séquence du Viol du vampire. J'ai aussi failli en être directeur. Il y avait un financement à la condition que l'on récupère le théâtre de la rue Chaptal, mais il n'y a pas eu moyen. Il y a une histoire trouble avec ce théâtre, on n'arrive pas à l'avoir.
S : Imaginons qu'un de vos films soit étudié à la FÉMIS... Lequel selon vous serait choisi ?
J.R. : Je ne connais pas assez la FÉMIS... Je n'en sais rien. Cela dépend dans quel but. Si c'est pour parler de la mise en scène ou de la technique, ils choisiraient certainement le plus riche, Les Raisins de la mort.
S : Et pour l'écriture ?
J.R. : Je dirais La rose de sang qui est un de mes bons scénarios.
S : Que ressentez-vous quand vous revoyez un de vos films ?
J.R. : Je ne les revois jamais, je déteste ça. Il m'arrive de feuilleter des photos, mais je n'aime pas revoir les films. Je n'en ai jamais vu dans une salle publique. Sûrement un vieux complexe qui date du Viol du vampire. J'ai peur que les gens me reconnaissent et me jettent des pierres ! De même, je fais très rarement plusieurs prises. Jean-Pierre Bouyxou dit qu'une fois que j'ai vu la scène et que la caméra a tourné, elle ne m'intéresse plus et je passe à la suivante.
S : Est-ce qu'il y a des réalisateurs que vous préférez actuellement ?
J.R. : J'ai une très mauvaise mémoire des noms... Jim Jarmush… Ça paraît curieux parce que c'est plutôt du cinéma nouvelle vague, mais j'aime bien ce qu'il fait !
S : Vous avez un amour très fort pour les serials de William Witney, mais votre style en est aux antipodes…
J.R. : On ne filme pas forcément ce que l'on aime chez les autres…
S : Que pensez-vous de l’œuvre de David Lynch ? Voyez-vous des points communs entre vous concernant la narration, l'emploi du symbole ?
J.R. : Je ne connais que sa série Twin Peaks que je regardais à la télé…
S : Est-ce que des suppléments sont prévus pour les sorties DVD ?
J.R. : J’en ai fait un pour le vidéodisque allemand de La morte vivante (1982). Il a fallu que je commente le film en anglais. Pendant une heure et demie, il a fallu que j’explique le film, ce fut affreux ! Sur les DVD, ils essaient de mettre des choses, des films-annonces quand ils les ont trouvés, des scènes coupées. Je n'ai pas encore vu les DVD... Ils ont repris les films en étalonnant les négatifs, il paraît que c'est d'une beauté folle... Je suis en pourparler avec Jean-Pierre Dionnet qui va faire du DVD et de la série B. C'est donc tout à fait pour moi. Je récupère les droits de tous mes films qui étaient diffusés en vidéo à la fin de l'année et je pense les vendre à Canal+ pour le DVD.
Nous remercions Jean Rollin pour la gentillesse et la disponibilité dont il a fait preuve à l’occasion de cette interview conduite par téléphone le 21 mars 2007 et reprise par ses soins.
Métaluna : Quelle a été la genèse de ce film ?
Jean Rollin : Mes activités se partagent entre l’écriture et le cinéma. Je passe du livre au film suivant l’inspiration. Je voulais donc un sujet dans lequel placer des extraits de tous mes films, en les intégrant à l’histoire comme des visions, par exemple. J’ai écrit une première version, puis d’autres, en tout une dizaine, sous le titre La nuit transfigurée. Aucune n’était vraiment satisfaisante. Il y avait un personnage masculin nommé Pirouli qui parlait, parlait… Aucun producteur n’était intéressé. J’ai donc essayé de « jouer dans la cour des grands » et je suis allé trouver des comédiens connus. J’ai contacté Bruno Kremer : aucune réponse. Elsa Zilberstein : silence également. Bernadette Lafont, qui devait me rappeler (j’attends toujours), Michael Lonsdale, Edith Scob… Tous ont refusé sous les prétextes les plus divers. Mais le pompon revient à Christine Boisson : elle a refusé le rôle de Madame Pesey sous prétexte qu’un de mes films avait fait peur à sa fille ! Finalement, c’est Jean Depelley qui m’a suggéré Nathalie Perrey, et cela m’a paru évident. Au départ, j’avais écrit le personnage en pensant à Christine Boisson, mais Nathalie s’est facilement glissée dedans. J’ai adapté le rôle pour elle.
La production semble avoir été difficile.
Oui, je ne trouvais pas de partenaires financiers. On m’a parlé d’Ovidie, « l’intellectuelle du X ». Je la vis pour un second rôle. Toute l’équipe la trouva si simple, si disponible, pas du tout bêcheuse comme je le craignais, qu’immédiatement après son départ nous nous sommes regardé avec la même idée : lui proposer le premier rôle. Le reste du casting a été difficile à établir. Entre les caprices des unes et des autres, ce n’était pas simple. Une sorte de magie a dirigé tout cela : Sabine Lenoël et Sandrine Thoquet, avec lesquelles j’avais déjà travaillé, se sont montrées les interprètes idéales. Mais je n’avais toujours aucun financement. Il fallait prendre une décision, le film attendait depuis trop longtemps déjà. J’ai donc assuré moi-même la production avec ce que j’avais gagné à la télévision grâce à Jean-Pierre Dionnet qui, le premier, m’a ouvert la route, et à Arte qui a passé La fiancée de Dracula. Enfin, j’avais l’aide de la Région Limousin. Nous nous sommes donc risqué à tourner.
Comment s’est passé le tournage ?
Ce fut un tournage invraisemblable. Il y eut plusieurs tournages éloignés les uns des autres, parfois de plusieurs semaines, ce qui posait des problèmes de dates, en particulier pour Ovidie… La plupart des décors parisiens, comme le Musée Orfila, n’existaient plus. Nous avons tourné en premier le Musée La Specola à Florence, car je ne voulais pas avoir les mêmes problèmes qu’avec les Musées parisiens. Mais en Italie, ils protègent mieux leur patrimoine artistique qu’en France ! Il suffit de voir ce qui est arrivé à ces deux merveilles qu’étaient le Musée Orfila et le Musée des monuments français… Après Florence, je n’étais pas certain du tout que le film aurait une suite… J’avais peur qu’il reste à jamais inachevé… Chaque fois qu’un peu d’argent rentrait, je faisais un nouveau tournage d’une journée, parfois deux. Ainsi, nous avons filmé les scènes du Père Lachaise, de la forêt incendiée, des voies abandonnées. Mais le gros morceau, le tournage de Limoges, restait à faire et j’hésitais. Enfin, poussé par les uns et les autres, je me suis lancé et nous sommes partis. Malgré les incidents tragi-comiques, par exemple Ovidie devenue blonde, une des actrices prévues enceinte (toute ma vie, j’ai eu des problèmes avec des comédiennes enceintes… Cela a commencé avec les jumelles que je n’ai pu que rarement avoir toutes les deux en même temps à cause de cela !), le film s’est achevé.
A l’instar de votre nouvelle, Le Dernier Livre, le film tourne autour de l’héritage artistique d’un cinéaste disparu. Est-ce un thème qui vous est cher ?
C’est la première fois que je le traite au cinéma. Plus je vieillis et approche de la mort, plus je pense faire mon dernier film. C’est un peu dans cet esprit que j’ai tourné celui-ci. Avec peu de moyens, mais je m’en fiche, je l’ai fait comme je l’ai voulu. Ce n’est pas un film sur moi, mais sur un cinéaste disparu. J’ai pris certaines choses personnelles, mais je ne suis pas Michel Jean…
On retrouve également vos mondes intérieurs accessibles à travers les portes des horloges.
Bien entendu. Je ne crois pas que l’on puisse faire quelque chose de valable pour les lecteurs et les spectateurs. Quand on s’exprime, c’est avant tout quelque chose de soi-même que l’on montre, et si cela touche le spectateur ou le lecteur c’est bien. Sinon, tant pis.
Il s’agit certainement de l’un de vos films les plus personnels. L’atmosphère est largement préférée à l’action. Est-ce un choix conscient ?
L’atmosphère vient en grande partie du mélange entre le tournage et les extraits de mes anciens films, ceux-ci arrivant tout à coup sans introduction ou préparation. Je n’étais pas sûr du résultat. Quand nous avons inséré, Janette Kronegger et moi, les premiers extraits dans le tournage de La Specola, nous avons été véritablement sidérés de la perfection des enchaînements. Mais il faut dire que Janette est une monteuse exceptionnelle ! Et puis cette dernière mouture du script, écrite dans la hâte, débarrassée des lourdeurs, allant à l’essentiel, était très stimulante. Certaines scènes me venaient même en tête la veille du tournage ! Cela a été vraiment une aventure difficile, je ne savais pas si le film serait tourné entièrement. Mais j’avais des aides précieuses, la Région Limousin qui a montré une patience remarquable, mes principaux techniciens et comédiens (ceux qui ont joué l’aventure jusqu’au bout), il faudrait tous les remercier. Et honte à ceux qui ont refusé l’aventure !
Ovidie est tout à fait remarquable dans le film de part son jeu et sa présence. Le choix d’une telle actrice n’est pas sans risque. Vous aimez jouer les poils à gratter du cinéma d’auteur ?
Ovidie est pour moi une revanche. J’ai voulu montrer à tous les imbéciles qui se prennent pour des critiques ou de futures actrices que c’est délibérément que j’ai engagé Ovidie, parce qu’elle est une véritable comédienne, parce que j’ai bien aimé son film de montage Qui a peur du grand méchant loup ? et parce que ceux qui pensent faire une carrière ne feront rien du tout. Parce que sa présence en premier rôle gêne les imbéciles. J’aime prêter le flanc aux ricanements que ne vont pas manquer d’avoir les connards prétentieux qui rigolent de mon travail. L’association Ovidie-Rollin montre de quel côté je me trouve.
Les seconds rôles sont des habitués de vos films.
Oui. C’était assez émouvant de retrouver des gens comme Maurice Lemaitre, qui avait joué en 69 dans La vampire nue, Jean-Loup Philippe qui avait été l’interprète de Lèvres de sang, L’itinéraire Marin, Killing car… Dominique Grousset qui avait joué Le frisson des vampires, Requiem pour un vampire… et d’excellents acteurs comme Sabine Lenoël et Sandrine Thoquet. Et bien entendu Nathalie Perrey, et ma propre femme Simone, énigmatique Promeneuse issue d’un de mes livres, qui jouait pour la première fois avec une présence qui m’a troublé
S’agit-il vraiment de votre dernier film ?
Je ne sais pas. Si c’est le cas, c’est une bonne sortie, je pense. En tout cas, je ne désire plus être producteur. Ou alors simple sleeping partner…
Avez-vous d’autres projets ?
J’aimerais bien faire un film de mon roman Tuatha. Et puis, je viens de terminer mes mémoires professionnelles et je cherche un éditeur. Ces deux projets sont assez pour l’instant.
Dans les yeux de Jean Rollin
©LCJ Editions & productions 2004®
Ci-dessous, une interview de Jean-Loup Philippe, chez Jean Rollin en mai 2005.
Jean-Loup Philippe ami de Jean Rollin, a joué dans plusieurs de ses films.
Nota bene : Le scénario L'itinéraire marin
est de Jean Rollin et non de Marguerite Duras qui en a écrit les dialogues.
Et non pas comme il a été souvent cité que le scénario est de Marguerite Duras, c'est une erreur.
Jean Rollin explique cela dans son interview donné en 2005, où il évoque les débuts de sa carrière.
Evocation du film
Mourir à l'aube
Evocation du film perdu
L'itinéraire marin
Evocation du film
Le viol du vampire
Evocation du film
Lèvres de sang
Evocation du film
Perdues dans New York
Evocation du film
La fiancée de Dracula
Prémices du film
La nuit des horloges
Ci-dessous, une interview du compositeur de musiques de films, Philippe d'Aram, chez Jean Rollin en octobre 2005.
Philippe a composé plusieurs partitions musicales pour nombre de films de Jean Rollin.
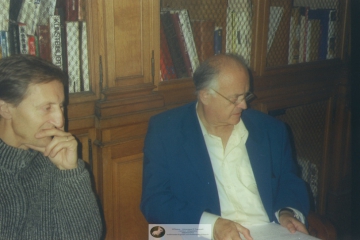



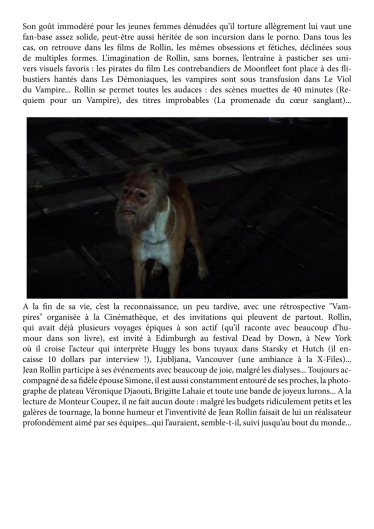


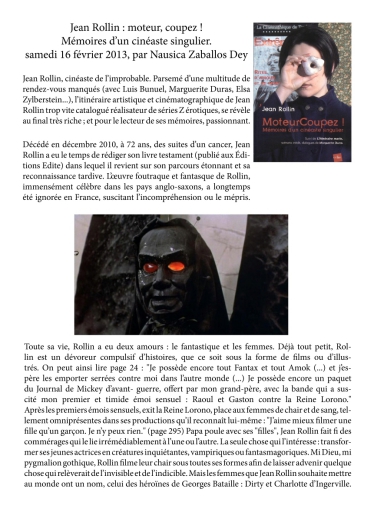
Extraits de films de Jean Rollin
©LCJ Editions & productions 2004®
Cliquez pour démarrer la vidéo







Les pays loins 1965
©les Films ABC®
Les amours jaunes 1958
©les Films ABC®
Les premiers films
de
Jean Rollin
Un bel article dédié à Jean Rollin et ses mémoires
MoteurCoupez !
Interview Jean Rollin mai 2005
Interview Philippe d'Aram octobre 2005
Interview Jean-Loup Philippe mai 2005
Jean Rollin,
sa carrière, ses films…
et sa plage fétiche de galets Pourville-les-Dieppes
G-E6NH8JM7S2
Thème musical La fiancée de Dracula de Jean Rollin - ©Philippe d'Aram®




sur le site officiel français dédié à
Jean Rollin, cinéaste-écrivain
03 novembre 1938 - 15 décembre 2010