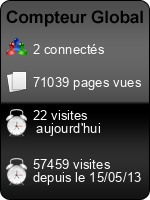©Photo : Véronique D.Travers®2017







Cliquer pour démarrer la vidéo











Arte TV Tracks









C'est un drôle d'exercice de parler de ce que l'on peut aimer dans le cinéma de Jean Rollin. Toujours l'impression de ne pas réussir à trouver les arguments prouvant le contraire à ses détracteurs, vu qu'entre amateurs, on ne parle pas de Jean Rollin. Pas besoin, on sait que les choses se jouent en intime. Je n'ai jamais vu de films de Jean Rollin accompagné, par exemple.
…Jean Rollin pour ainsi dire…
Commençons par ce qui relève de l'évidence, manière d'objectiver le sujet. Il y a un profond malentendu sur le cinéma de Jean Rollin. Non, on ne peut pas réduire son cinéma à une série de pellicules datées où des femmes vampires en nuisette errent sur une plage bretonne à la recherche d'un cercueil pour prendre le large ou d'un marin pour se sustenter. Ça, c'est pour le cadre, fantastique par essence, érotique en conséquence. Le goût de l'amateur de mystères en feuilleton. Derrière ce décorum se cache un cinéma d'errance jamais loin de certaines échappées de Franju et Resnais, de leur goût pour un réalisme disloqué hérité de débuts où ils officiaient aux commandes de documentaires à la poésie déclarée. Citons aussi en valeur d'exemple Cocteau et son cinéma personnifié toujours entre les deux mondes. Quand on regarde un film de Cocteau, on sait que l'on regarde un film de Cocteau, on le voit. Pour Jean Rollin, c'est la même chose. Un oeil, assurément.
Parce que Jean Rollin sait faire du cinéma. Pour s'en convaincre, revoir la longue séquence d'ouverture de Fascination, l'équipée noctambule dans le Paris endormi des Lèvres de Sang ou encore sa façon d'insérer à la hussarde dans les Démoniaques les séquences de l'éruptive Joëlle Coeur. Le temps y est soit étiré, soit comprimé, toujours maitrisé. On s'amuse souvent des seules séquences chez Jean Rollin a prêter vraiment à rire (et on précise bien volontairement), celles arrivant en fin de métrage où le cinéaste tente de recoller les morceaux en toute vitesse, la scène explicative en passage obligé histoire de ne pas perdre le distributeur en route. Là, le théâtre du faux de Rollin justifie la mascarade, les comédiens ânonnent sans incarner (un monde de poupées comme l'a théorisé Mamoru Oshii), le temps (qui depuis le début aller vaille que vaille, claudiquant sur les chemins de traverse de l'inconscient) retrouve brutalement les rails grande ligne puis retourne s'assoupir en classe affaire. La messe est dite. Puisque tout est faux, tout est possible. Le film que vous regardez n'est pas le film que vous pensiez. Au contraire, c'est un film auquel vous allez croire. Parce que l'on ne regarde pas un Rollin en regardant derrière soi. Non, croire plutôt que penser (soit cette fameuse scène du travelling circulaire dans Le Viol du Vampire). Seule manière d'entendre la petite musique millimétrée. Au moins le carillon des pendules à minuit.
Donc Jean Rollin est Jean Rollin. Les faits s'imposent à la faveur d'une étude de sa filmographie. On peut (et on doit) parler de son goût pour les vampires, figures séduisantes, suaves du bestiaire fantastique et personnages en axe principal de son cinéma. Mais on doit aussi parler plus largement de ce regard en biais sur le monde, du regard social de Jean Rollin. Guère étonnamment, le regard que pose une personne seule sur le monde, un monde seulement éclairé d'une lumière crue, attentive, ce regard même est de toute évidence unique. Les visions de Rollin sont donc uniques. Uniques par l'articulation entre un réel qui n'existe pas (le ton volontairement théâtrale des acteurs) et des fantasmagories qui ont donc pour le coup toute latitude d'exister puisque n'ayant plus à se justifier au regard d'un réel de valeur zéro (les scènes de justification étant, on l'a vu, intéressantes pour autre chose que ce qu'elles semblent être).
Mais alors que voit Jean Rollin? Eh bien Jean Rollin voit un monde triste qu'il tente de réenchanter, de rendre à nouveau désirable. C'est parce que ses héros et héroïnes éprouvent du désir qu'ils et elles sont séduits par des vampires. Désir de sortir d'un milieu morne, ennuyeux, mortifère. Prenez par exemple la scène du vernissage au début de Lèvres de Sang et l'irruption du désir (en soi l'irruption de la fiction) qui accompagne la mystérieuse photo du château. Un désir qui pousse notre héros dans des aventures fort rocambolesques (car traverser les cimetières de Paris la nuit, avoir des rendez-vous secrets dans un aquarium est rocambolesque). Et un désir qui fait un film. Il y a du Kuchar chez Rollin. Pas par goût (ce n'est pas une théorie), mais par désir (c'est un constat). Les ficelles sont là, tout le monde les voit, les masques rient et le spectateur aussi, dans la confidence, enchanté. Car puisque Rollin nous montre des personnages/acteurs usant et abusant de tricheries pour s'échapper, le spectateur est lui aussi en droit de tricher. De croire, pour ainsi dire.
Si, sur ce thème de l'échappée belle, le vampire est par le mécanisme de séduction qui le régit (bourreau et victime à la fois) la figure idéale pour développer sur l'air de «j'y vais, j'y vais pas», Jean Rollin porte aussi un regard débarrassé du décorum assez aigu sur ses contemporains, même si cela reste un regard qui tente de dégager des moyens concrets à l'échappée. Mais peu de chance de fuite dans le réel, en témoigne l'atonie triste de La Nuit des Traquées et des Paumées du Petit Matin, films d'une grande solitude, comme certains parlent des villes. Et grands films de solitude aussi. Autre approche du réel et de sa possible échappée, Perdues dans New York, titre programmatique pour film culotté. Culotté puisque l'argument de fiction s'effiloche petit à petit au profit d'une ballade subjective à travers la ville, carnets de voyage où Rollin met à nue sa mécanique de reddition du réel, son échappée non-fictionnel dans l'art. D'une grande sincérité, Perdues dans New York est assez bouleversant, pour faire dans le sentimentalisme. Mais comme c'est ce même sentimentalisme qui, une fois la machine démontée, continue d'irriguer un Sans Soleil, pourquoi s'en priver?
En attendant le carillon des pendules à minuit.
Copyright 2009 Blog of Terror

Les différents niveaux de lecture, de par la complexité de leur agen- cement, permettent à Stocker de conforter l’idéologie victorienne et d’introduire les nouvelles sciences de l’anthropologie criminelle et de la psychiatrie dans un roman pourtant fort conservateur. Ces scien- ces, censées supplanter la vieille médecine et surtout les croyances religieuses caduques, viennent combler un vide idéologique angois- sant en cette fin de siècle. Le roman de Stocker permit sans aucun doute de rassurer, malgré l’effroi provoqué par le comte Dracula, le lectorat victorien. Celui-ci, à défaut de s’être réellement fait peur, se sera sûrement repu de la fuite érotique du texte qui échappa à l’auteur, offrant aux médecins quelques nombreux cas d’onanisme incontrôlé. Quand la littérature relaye la psychiatrie, il est parfois rassurant de constater qu’elle la nourrit bien plus qu’elle ne la sert.
Ian Geay
Une autre contagion touche enfin le roman, que nous imagi- nerions volontiers sorti d’un épais dossier de l’asile d’aliénés de Pavie. Et si toute cette histoire n’était qu’une histoire de fous, de l’art brut aux résonances littéraires trompeuses... Lucy est internée, au même titre que Renfield et que la jeune Mina, dans l’hôpitalde son prétendant. Ils partagent tous, avec Jonathan Harker, une lubie vampirique dont le jeune clerc de notaire s’est fait le vecteur. Une démence commune que le docteur Seward consigne dans un dossier purement artistique, que nous appréhendons comme un roman fantastique. La caution de cette analyse repose sur le personnage du docteur Van Helsing, véritable matérialisation du cas pathologique exposé par Lombroso sous le terme générique d’hystérique. Tout laisse croire, dans le roman, que le vieux méde- cin hollandais est un charlatan complètement dément et potentielle- ment dangereux . Le roman de Stocker n’est plus, dès lors, qu’une déclinaison des différents modèles de criminalité et de folie présen- tés dans l’œuvre de Lombroso. Peuples errants, aliénéEs, femmes insoumises ou immigréEs sont autant de corps étrangers que les grandes nations stigmatisent à travers la psychiatrie fin-de- diècle. La médecine relaye ainsi le pouvoir dans le contrôle hygié- nique du corps social et investit les domaines de la physiologie, de la morphologie et de la sexualité pour épurer le pays de la fange du peuple. Femmes et Étrangers, de par l’apparente étrangeté de leurs corps, furent une fois de plus la cible privilégiée d’une forme d’exclusion dont nous mesurons aujourd’hui encore les effets, grâce, entre autre, à la propagation de la littérature.
20 – Chaque guerre nous rappelle tristement la récurrence du viol comme arme du génocide, notamment dans les conflits inter-ethniques.
21 – Bram Stocker, op. cit., p. 490.

Solé,
Pilote, n° 719, 16 août 1973

Stocker jette le discrédit sur les comparses de Dracula à travers leur propre sexualité : ainsi, Mina est réduite à son seul sexe après avoir reçu la marque de l’hostie sur le front, juste au-dessous des cheveux, comme pour mieux figurer la Vulve pécheresse. Elle doit alors exhiber publiquement cet affront, cette marque d’infamie, en vue d’expier son péché : littéralement, celui de s’être liguée contre le vampire ; plus sournoisement, celui de promouvoir les « nouvel- les femmes » présageant sans aucun doute les suffragettes du début du siècle. Celle qui pouvait ainsi s’affranchir des conventions sociales strictes – comme ces déclarations sur le rôle des femmes ou le journalisme le laissaient espérer – réintègre les rangs chastes et bien pensants de la bourgeoisie anglaise après s’être compromise avec l’envahisseur. Elle prouve que la femme ne peut s’affranchir de sa condition car elle est « faible du sexe » : en somme, la femme est celle qui trahit, qui menace le territoire et la race, notamment lorsqu’elle tente de s’émanciper : voilà une justification de la domi- nation masculine et de la reconquête du corps féminin que Stocker fond à son roman, pour le moins réactionnaire.
En effet, la croisade contre l’ennemi cache une autre croisade : le corps de la femme, réduit à un champ de bataille, devient un terri- toire à défendre au même titre que le territoire national. Le docteur Van Helsing entreprend ainsi une véritable course sexuelle contre Dracula, car l’Occident est menacé par le métissage et le mélange des sangs opérés lors de la succion vampirique. À ce sacrifice barbare, la médecine oppose la transfusion sanguine, érotisée au paroxysme, et qui a pour but de réintroduire dans le corps de Lucy the right, young and strong blood. Pourtant, le vieux médecin sait que par cette triple transfusion, il se livre à une véritable messe orgiaque et qu’il transforme la jeune fille en polyandrie ; néan- moins, l’acte sexuel, au même titre que le combat physique contre Dracula, est un moyen de lutter contre l’ennemi : le corps fémi- nin, assimilé au corps étranger et déviant, doit être contrôlé voire purifié 20. Nous imaginons sans rougir le professeur Van Helsing, nécrophile qu’il est, satisfaire la cause nationale, le pieu à la main en rappelant que les amours de cimetière ne sont qu’une déclinaison du désir de domination machiste intrinsèque aux violences sexuel- les : sous prétexte de défendre sa race et l’avenir de l’île, le médecin viole sans vergogne le corps de la jeune fille considérée comme ennemie du grand peuple anglais. Et toute cette belle histoire de finir par la colonisation des terres transylvaines via le tourisme, et par l’asservissement du corps féminin à travers l’arrivée d’un enfant, consécration d’une victoire raciale décidément bien méritée. Comment ne pas sourire dès lors à la lecture des derniers mots de Van Helsing : « Ce garçon saura un jour quelle femme courageuse est sa mère. Déjà il connaît quelle est sa douceur et son amour. Il comprendra plus tard que quelques hommes l’ont aimée et pour son salut, ont beaucoup osé. » 21
16 – Sur ce thème, voir :Dr. Bienville, La Nymphomanie ou traité de la fureur utérine, [1771], Paris, Le Sycomore, 1980, (préface de Jean-Marie Goulemot) et Frénésie, n° 4 (« Hysterus »), automne 1987.
17 – Bram Stocker, op. cit., p. 129.
18 – Idem., p. 379.
19 – Marie-Anne Van Spitael,« Dracula, un roman à facettes », Les Cahiers de l’Herne,« Dracula », Paris, 1997, p. 97-107.

Lucy Westerna est le type même de la criminelle épileptique tant son somnambulisme et ses « crises utérines » 16 régentent son corps. Elle ne résiste pas à l’attrait sexuel du comte, et, comble de la délinquance, elle semble jouir du déflorage vampirique qu’elle subit : « Alors, il sembla ne lus exister [...] mon âme s’envolait de mon corps, flottait dans les airs [...] Je crois me souvenir que le phare ouest se trouvait juste en dessous de moi, puis j’ai eu une sensation de douleur, comme si je me trouvais au milieu d’un tremblement de terre, et enfin je suis revenue à moi. » 17
La meilleure amie de cette jeune femme, Mina, présente quant à elle des signes avancés d’hystérie et son agression, à travers laquelle nous découvrons une scène de fellation, fait irrémédiablement écho au passage orgasmique décrit ci-dessus : « Il déboutonna le plas- tron de sa chemise et, de ses ongles pointus, s’ouvrit une veine de la poitrine. Lorsque le sang commença à jaillir, d’une main il saisit les deux miennes de façon à me rendre tout geste impossible, et de l’autre, il me prit la nuque et, de force, m’appliqua la bouche contre sa veine déchirée : je devais donc, soit étouffer, soit avaler un peu de... Oh ! mon Dieu, qu’ai-je fait pour devoir endurer tout cela, moi qui ai pourtant toujours essayé de marcher humblement dans le droit chemin ? » 18
Stocker ne pouvait plus élégamment décrire la fureur utérine qui possède les jeunes femmes de son roman. Marie Van Spitael commente cette utilisation de la femme à des fins purement poli- tique : « En succombant à Dracula, la femme suppôt de Satan, se montre fidèle à sa véritable nature, celle des débordements sexuels que la société et la religion se sont ingéniées à brider pendant des siècles. Incapable de surmonter les épreuves, à cause de son imbécillité naïve, elle ne peut survivre à une initiation qui la révèle elle-même. » 19
14 - Notez à ce propos que Lombroso s’est défendu de l’interprétation abusive de ces thèses dans un ouvrage intitulé L’antisémitisme, publié en 1899, ouvrage qui tend à prouver que le Juif est descendant de la race aryenne et qui condamne donc toute discrimination de type antisémite. Il fut peu lu...
15 – « If Renfield is obviously a Lombrosian criminal type,who comes under Dracula’s power because of their biological and psychological kinship, Lucy Westerna is less obviously so. » Ernest Fontana, « Lombroso’s criminal man and Stocker’s Dracula », in The Victorian letters, n° 66, 1984, p. 25-27.
Une pléthore d’autres éléments physiques anime l’adaptation littéraire du texte scientifique : androgynie, regard perçant ou force surhumaine ornent la description psychique du comte, puisque Stocker insiste sur la caractéristique majeure du criminel-né qui, selon Lombroso, dote l’individu malade d’un cerveau d’enfant, et ceci, malgré une potentielle intelligence... L’utilisation faite par Stocker de ces thèses hasardeuses a, nous l’avons souligné, une prétention politique qui présente le vampire comme un enva- hisseur, et l’étranger comme un criminel-né : syllogisme douteux s’il en est, mais qui ancre la stigmatisation des corps déviants dans l’imaginaire collectif. L’étranger qui menace l’intégrité de l’Angle- terre est stigmatisé dans un visage et une psychologie bien particu- lière que la Science a révélé et que le lectorat peut aisément saisir comme étant la figure du Juif. Il ne reste, pour s’en convaincre, qu’à se rapporter aux descriptifs du peuple juif dans la propagande nationale socialiste, fièrement plantée sur les thèses médicales de la fin du siècle dernier et de les comparer au portrait fait du criminel par l’aliéniste italien... 14.
Ernest Fontana montre néanmoins que Stocker utilisa également le modèle lombrosien pour construire les personnages de Renfield, de Lucy et de Mina 15. Si le premier correspond traits pour traits au fou moral décrit par Lombroso, toutes les femmes présentent quant à elles les symptômes de ce que l’anthropologue appelle le criminel épileptique ou l’hystérique. Fontana met ainsi l’accent sur le formidable éclairage que constitue l’Uomo deliquente, notam- ment au niveau de l’assimilation du corps féminin au corps étran- ger. En effet, selon les spécialistes, seul un proche du vampire Ernest Fontana montre néanmoins que Stocker utilisa également le modèle lombrosien pour construire les personnages de Renfield, de Lucy et de Mina 15. Si le premier correspond traits pour traits au fou moral décrit par Lombroso, toutes les femmes présentent quant à elles les symptômes de ce que l’anthropologue appelle le criminel épileptique ou l’hystérique. Fontana met ainsi l’accent sur le formidable éclairage que constitue l’Uomo deliquente, notam- ment au niveau de l’assimilation du corps féminin au corps étran- ger. En effet, selon les spécialistes, seul un proche du vampire peut lui ouvrir la porte de la maison : Dracula ne peut donc pénétrer le sol anglais qu’avec le consentement d’un des siens. Or, la mère de Lucy partage avec le vampire un statut criminel puisqu’elle livre son enfant aux dents du vampire en ouvrant la fenêtre de sa chambre. La femme, dénuée de sentiments maternels et de fibre protectrice est, selon le schéma lombrosien, une mère indigne, voire une criminelle : c’est donc à travers cette communion du crime que le vampire réussit à s’immiscer au sein de la vie organique du pays et nous comprenons alors l’enjeu du texte : la femme fin-de-siècle est à la fois le maillon essentiel dans la reproduction d’une race, et l’élément qui peut entraîner sa dégénérescence.

12 – Idem, p. 26.
13 – Cesare Lombroso, L’Homme criminel, 1876.
« Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d’aigle ; il avait le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes mais abondant sur le reste de la tête ; les sourcils broussailleux se rejoignent presque au-dessus du nez, et leurs poils, tant ils étaient longs et touffus, donnaient l’impression de boucler. La bouche ou du moins ce que j’en voyais sous l’énorme moustache avait une expression cruelle, et les dents éclatantes de blancheur étaient particulièrement pointues ; elles avançaient au dessus des lèvres dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles, et vers le haut se termi- naient en pointes ; le menton large annonçait lui aussi de la force et les joues, quoique creuses, étaient fermes. Une pâleur étonnante, voilà l’impression que laissait ce visage. » 12
Singulière ressemblance avec le portrait type du criminel-né chez Lombroso : « Le nez souvent aquilin, ou croche comme celui des oiseaux de proie, toujours volumineux ; les mâchoires sont robustes, les oreilles longues, les pommettes larges, les cheveux crépus sont abondants et foncés. Assez souvent, la barbe est rare, les canines très développées, les lèvres fines [...] le menton large et saillant. » 13
Jean-Michel Nicollet, 1987

9 – Milagros Palma, La Femme nue ou la logique du mâle, Paris, Côté-femmes éditions, 1991.
10 – « Plagiocéphalie (du grec plagios, oblique et kephalé, tête). Conformation vicieuse de la tête. »
(Extrait du Grand Larousse Encyclopédique, 1964). L’asymétrie faciale correspondait pour Lombroso à un signe probant de criminalité.
11 – Bram Stocker, op. cit., p. 445
La bisexualité du vampire est ainsi utilisée pour accabler un peu plus celui qu’il faut éliminer car, non content de menacer l’ordre social et racial du pays, il risque de bouleverser l’ordre sexuel de par ses pratiques subversives. Néanmoins, Stocker, victime lui-même du scientisme, s’avère soucieux de soutenir son texte au moyen d’arguments scientifiques, et trahit dès lors un fantasme purement réactionnaire : fondre l’exclusion et le racisme dans un cadre légitime car médical.
En se référant à l’œuvre maîtresse de Cesare Lombroso, L’Uomo deliquente (L’Homme criminel, 1876), Stocker fait appel à un scientifique reconnu. Il utilise la thèse du médecin aliéniste selon laquelle le crime n’est pas un acquis lié au milieu social, mais est une inclination de la nature inscrite dans la morphologie même du délinquant. À grands renforts d’anecdotes ornithologiques ou mythologiques et de récits flirtant avec le fantastique, Lombroso dépeint une série de tableaux effrayants censés prouver l’universa- lité de l’activité criminelle. L’angle scientifique noie néanmoins ce folklore dans une masse incommensurable de mesures anthropo- métriques démontrant de manière définitive les liens entre la taille des cerveaux, l’asymétrie faciale ou la plagiocéphalie 10 et les formes de dégénérescence et de délinquance chez les indivi- dus étudiés. Ainsi émane de cet atelier artistico-scientifique une description détaillée de la physionomie criminelle, celle-là même que Stocker exploite dans son roman et qui corrobore la trame xénophobe du récit. « Le comte est un criminel du type criminel, dit-elle. Nordau et Lombroso le mettraient dans cette catégorie, et parce que criminel son esprit est resté imparfait » 11. De ce point de vue, la description physique du comte est éloquente :
Nosferatu fantôme de la nuit, film de Werner Herzog, Allemagne-France, 1978


Une fois encore le spectre de Vlad Tepes hante le vampire fin de siècle dans un bal des horreurs très particulier où valsent bourreaux, travestis et invertis... car se profile derrière l’éclat ciné- matographique de la dent vampirique le pal de l’ignoble empereur. Nul doute qu’il symbolise un phallus fièrement dressé, celui qui, rappelons- le, a pour fonction d’embrocher l’impie, de l’anus à la bouche : le supplice évoque indubitablement la sodomie et contamine à travers son pseudo- nyme le vampire qui menace de sa dentition toute une nation. La pédérastie du nom est d’ailleurs mis en exergue dans le texte français puisque la traîne onomastique du nom vise le fondement
et rappelle au lecteur, dans un avertissement phonique évident, que la bouche ne renvoie pas, comme beaucoup l’ont avancé, au sexe héritier de Milagros Palma 9, mais bien à l’anus car la dent perfore puis aspire, comme lors de l’excrétion, l’actif cède à la passion – tout du moins au subit.

7 – Gérard Stein, « Dracula ou la circulation du sans », Littérature 8, décembre 1972, p. 93.
8 – Nous vous conseillons pour saisir l’étendue de cette analyse de lire le délicieux « Drencula », in Boris Vian, Écrits pornographiques, Paris, 10/18, 1993, p. 95-107.

Bref, et pour être aussi net que la morsure du comte, le patronyme dote le texte d’une indéniable dimension politique qui désigne le vampire comme étant le stéréotype du corps étranger en passe de contaminer le corps national. Gérard Stein dans son célèbre article « Dracula ou la circulation du sans » a posé ainsi le problème : « En roumain, Drak signifie “diable”. De ce mot, le roumain peut tirer aussi bien un mot masculin drak-ul, qu’un mot féminin, drak-a ; il n’est pas dépourvu de signification que les suffixes des deux sexes composent le nom Drak-ul-a. Les psychanalystes qui ont tenté d’assimiler le baiser vampirique à l’acte sexuel ont été arrêtés, en fait, par le rôle à la fois masculin et féminin du suceur de sang qui d’une part pénètre, mais de l’autre aspire » 7. Dracula est évidemment décrit sous les traits d’un homosexuel. Une carac- téristique du vampire vient compléter le portrait robot de l’étranger qu’il faut bouter hors de l’île 8.
Manifestation ouvrière se moquant du thème du couteau entre les dents, 1919


Si le terme vampire était utilisé lors de la Révolution française par les sans-culotte pour fustiger les tenants du pouvoir, pour Stocker,en revanche, le vampire désigne à présent celui qui se nourrit de la substance de l’autorité et de la légitimité, rejoignant ainsi l’ar- senal sémantique de la contre-révolution. Outre le rôle de spectre suceur de sang, il recouvre les traits du barbare, ou du déviant, qui menace l’intégrité physique de la nation et de ses constituants. L’auteur, pour appuyer cette barbarie, oppose, non sans un certain talent, la modernité d’une Angleterre civilisée au retard sensible des peuples moldave et valaque : machine à écrire et phonographe contre sorcellerie et envoûtement. D’autre part, l’animalité qui les caractérise leur confère un aspect inquiétant et rappelle la dégé- nérescence de populations éloignées de tout centre de civilisation : ainsi, le premier contact avec les autochtones se fait avec des loups et Jonathan Harker vérifie rapidement le caractère protéïforme du vampire qui se transforme à sa guise en chauve souris, en rat ou en loup.
Le texte infuse l’animosité de Dracula d’une manière discrète puisque la menace qu’il représente est soutenue par une fourberie qui transcende la xénophobie du lecteur éclairé de l’époque victo- rienne; en effet, l’anglais d’alors ne craint pas l’invasion franche et directe des pays voisins mais redoute comme la peste l’invasion sournoise de populations scélérates qui polluent le corps sain et lisse de la nation. Le roman exploite ainsi l’émoi du lectorat face à une transfusion douloureuse de corps étrangers à travers la succion vampirique, métaphore filée du métissage. Sucer le sang, dans l’inconscient victorien, revient à mélanger 6 les essences qui garantissent à chaque peuple grandeurs et misè- res. Cette suscion illustre alors le risque que courent les grandes nations de voir leurs peuples dégénérer au contact d’autres popu- lations à l’atavisme animal. Et, pour parfaire la trame xénophobe du récit, la paranoïa injectée par l’auteur est amplifiée au moyen des nombreuses occurrences racistes du texte qui fustige à souhait les noirs, les peuples slaves et, en négatif, le juif errant, véritable fils du diable... Drakul, drakul... !

« Le Vampire », lithographie
de C. J. Brodtmann, 1827


4 – Jean Fabre, Le Miroir de sorcière essai sur la littérature fantastique, Paris, José Corti, 1992, p. 229.
5 – Bram Stocker, Dracula, [1896], Paris, J’ai Lu, « Épouvante », 1994, p. 29.
6 – De se mélanger, riche expression des quartiers nord de Marseille pour désigner l’acte sexuel...
Dès la première rencontre du comte avec le jeune clerc Jonatahan Harker, Stocker introduit les prétentions expansionnistes du vampire dans des termes à peine déguisés comme le prouve ce dialogue engourdi de courtoisie : « Ici [en Transylvanie] je suis un gentilhomme, un boyard ; les petites gens me connaissent ; pour ces petites gens, je suis un seigneur. Mais être étranger dans un pays étranger, c’est comme si on n’existait pas. [...] J’ai été maître pendant tant d’années que je veux le rester. » 5

1 - Voïvode ou Voïévode (du serbo-croate voï, armée, et voditi, conduire). Primitivement chef d’armée, puis gouverneur, dans les pays slaves. »
(Extrait du Grand Larousse Encyclopédique, 1964).
2 – Entendez sémitique.
3 – Au sens deleuzien du terme : il est plus géopolitique (donc horizontal) qu’historique (vertical) : ainsi, avant d’être le digne descendant d’une longue lignée d’envahisseurs, le comte Dracula est un mythe qui traverse l’Europe entière à la fin du XIXème siècle.
Pour Jean Fabre, « le barbare Dracula figure la crainte insulaire et xénophobe d’une invasion étrangère » 4. Son analyse révèle un héritage sanguinaire et barbare propre à faire trembler au plus profond de leurs entrailles les lecteurs victoriens, carrés dans une culture de plus en plus réactionnaire et isolationniste. Ce roman n’est autre que le récit de la tentative d’invasion de l’Angleterre fin- de-siècle par un être perfide, digne représentant d’une race dégénérée qui menace l’ordre social d’une nation inquiète de son sort. Toute la trame s’organise ainsi autour de la vindicte d’une poignée de croisés chrétiens, partie en lutte contre le péril juif, et qui réussira à bouter l’ennemi hors des sacro-saintes frontières de la nation.

Vlad Drakul IV, Anonyme, Kunsthistorisches Museum, Vienne


L’interprète ne peut donc faire l’économie d’une dissection complète et sanglante du patronyme car l’examen de cette jugulaire est impliqué par la lecture même du roman. Dracula renvoie au tyran roumain dont le surnom Drakul a marqué l’histoire de son sceau sanglant. Mais le choix d’une telle référence n’est pas innocent et s’éclaire si l’on considère l’orientation xénophobe du roman stockérien.
« Dracula » est avant tout surface 3 et comme la peste, il a vocation de s’étendre : de la rive gauche du Danube aux confins moldaves et valaques, il règne en maître sur les terres transylvaines. Déplacer le récit de l’Angleterre victorienne vers les contrées les plus reculées des Carpates est un choix authentiquement straté- gique de la part de Stocker qui désire faire assumer à son vampire la parenté avec l’Empereur sanguinaire et contaminer son récit de l’essence du géniteur.
Dracula n’incarne donc plus seulement l’ambassadeur d’une région aux frontières mal délimitées, mais aussi et surtout ce conquérant qui nie les frontières, l’épidémie qui se propage sans foi ni loi ; bref, nous entrevoyons avec effarement ces peuples errants qui menacent l’intégrité des vieux pays civilisés. Le patronyme absorbe dés lors plus qu’une géographie puisqu’il figure le péril oriental et la fureur de sa propagation.
L’énigme qui drape l’architecture des noms dans le Dracula de Bram Stocker est peut-être de même nature que celle qui gît dans les vieilles bâtisses gothiques d’un Sade ou d’une Radcliffe ; le château testamentaire de Stocker ne déroge d’ailleurs pas à la règle puisqu’il séquestre au sein d’une enceinte aussi phallique qu’utérine l’énigme du roman qui conditionne toute la création romanesque. D’ailleurs, si d’aucuns ne voient dans le nom du protagoniste qu’une lointaine référence au très historique Vlad Tepes, voïvode 1 de Valachie qui fit régner la loi du pal sur les plaines du Danube au XVème siècle, nous y voyons quant à nous ce qui conditionne l’écriture même du roman éponyme : Dracula, de par sa configuration phonique et sémique 2 prédétermine l’œuvre.
Le patronyme marque en effet le récit de son poids phonétique et l’informe d’une charge sociale et historique que nous ne pouvons taire : il est la condition même de la création romanesque puis- qu’il influe directement sur la quintessence du roman en orientant la trame, sorte d’infrastructure onomastique qui sous-tend l’ensemble de l’œuvre.
Un article envoyé par mon ami Jann Halexander sur le thème du vampire et de la sexualité…
Dracula, l’exclusion sanglante
par
Ian Geay




G-E6NH8JM7S2


sur le site officiel français dédié à
Jean Rollin, cinéaste-écrivain
03 novembre 1938 - 15 décembre 2010